
- Recherche par auteur ou oeuvre
- Recherche par idée ou thème
- Recherche par mot clé
- Détecteur de plagiat
- Commande & correction de doc
- Publier mes documents
- Nos astuces
- Vie étudiante
- Témoignages
Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Exemples de sujets de dissertation sur la Guerre froide
La Guerre froide est l'un des principaux thèmes du programme d'histoire du lycée, et se révèle particulièrement passionnante. Nous vous donnons ici quelques idées de sujets relatifs à la Guerre froide pour des dissertations, avec quelques-uns des éléments clés à aborder pour réussir vos examens.

Credit Photo : Freepik mb-photoarts

Au cours de cette période, les affrontements entre Russes et Américains sont nombreux et violents, causent de nombreux morts et placent l'intégralité de la planète sur un équilibre risqué, instable et dangereux. Les deux grandes puissances sont alors dotées de la bombe atomique, et l'affrontement utilise ces armes comme dissuasion, tout en espérant que personne n'en fera usage sans quoi les dommages seront conséquents.
Sujet 1 - Guerre froide et idéologies
Idée de sujet : la Guerre froide peut-elle se réduire à une guerre d'idéologie ?
Il sera intéressant de montrer que la Guerre froide intègre bien entendu une forte dimension idéologique, avec l'affrontement frontal entre communisme et capitalisme. Néanmoins, elle recouvre également une dimension liée à la puissance, chacun voulant prendre le dessus sur l'autre pour prouver au monde entier sa suprématie.
Sujet 2 - Guerre froide et affrontement de la baie des Cochons
En 1962, à Cuba , la Baie des Cochons est le théâtre d'affrontements majeurs entre Russes et Américains. Cet épisode marque un tournant dans la Guerre froide.
Idée de sujet : en quoi l'épisode de la baie des Cochons marque-t-il un véritable tournant dans la Guerre froide ?
Il sera intéressant ici de montrer que les oppositions entre Russes et Américains vont évoluer de façon significative suite à l'épisode de la baie des Cochons, et d'utiliser plusieurs comparaisons pour montrer ces différences.
Sujet 3 - Guerre froide et colonisation
La colonisation du monde et en particulier de l'Afrique est un des outils qu'utilisent Russes et Américains pour poursuivre leur Guerre froide.
Idée de sujet : en quoi la colonisation du monde est-elle un outil clé dans le cadre de la Guerre froide ?
On pourra ici démontrer que les affrontements de territoires relatifs à des colonies sont des éléments centraux qui font une véritable différence pour les Russes et les Américains, et sont donc des évènements clés de la Guerre froide qui les oppose.
Sujet 4 - Guerre froide et fin du conflit
Idée de sujet : quels ont été les éléments déclencheurs de la fin de la Guerre froide ?
La Guerre froide est un conflit sourd et sournois qui a fait rage à l'échelle planétaire pendant plus de 40 ans. Quels ont été les évènements qui ont conduit à l'arrêt de cette Guerre froide et à la chute de l'URSS ?
Sujet 5 - Guerre froide et début des affrontements
Idée de sujet : après la Seconde Guerre mondiale, quand et comment s'installe la Guerre froide ?
Il sera intéressant ici de montrer qu'alors que la planète pensait être enfin en paix après un violent conflit mondial qui a duré six ans, elle bascule très vite dans la Guerre froide, pour de multiples raisons. On pourra ici détailler ces causes et montrer comment les premiers évènements et affrontements ont été source de disputes bien plus importantes dans les années qui ont suivi.
Sujet 6 - Guerre froide et Guerre du Vietnam
Idée de sujet : en quoi la guerre du Vietnam est-elle une illustration parfaite de la Guerre froide, et un évènement clé ?
La Guerre du Vietnam est un évènement absolument central dans la Guerre froide, et il sera intéressant d'en détailler les causes, les faits, les conséquences sur les deux grandes puissances qui s'affrontent.
Sujet 7 - Guerre froide, Printemps de Prague
Le Printemps 1968 est une étape clé dans la Guerre froide et dans son évolution.
Idée de sujet : quel rôle a joué le Printemps de Prague dans le conflit de la Guerre froide ?
Il sera particulièrement intéressant d'étudier quels ont été les jeux de pouvoir et les évolutions des équilibres entre les grandes puissances dans le cadre et à la suite du Printemps de Prague. Il ne faudra pas ici se contenter de donner les faits, mais aussi, et surtout, les analyser pour comprendre les mécanismes et les bouleversements.
Sujet 8 - Guerre froide et Guerre des Étoiles
Idée de sujet : en quoi la Guerre des Étoiles est-elle un élément moteur de la Guerre froide ?
Les deux géants mondiaux s'opposent sur tous les fronts, sur terre, mais aussi dans le ciel, où la conquête spatiale fait rage. On peut s'interroger sur le rôle crucial de la conquête de l'espace à cette époque où tout est sujet à opposition.
Sujet 9 - Guerre froide et Willy Brandt
Idée de sujet : quel a été le rôle de Willy Brandt dans la Guerre froide ?
Willy Brandt a joué un rôle déterminant dans la Guerre froide, et on pourra analyser ses principales décisions et sa politique dans son ensemble, pour en étudier l'impact sur les puissances qui s'affrontent.
Sujet 10 - Guerre froide et coexistence pacifique
Les premières années de la Guerre froide sont placées sous l'aune de la coexistence pacifique .
Idée de sujet : comment et pourquoi la coexistence pacifique prend-elle fin ?
Quels sont les éléments qui font basculer les deux géants dans un conflit plus musclé, plus violent, plus dangereux ?
La Guerre froide est une époque passionnante qui couvre de nombreux sujets, presque tous les pays du monde, la conquête de l'Espace, celle de la bombe atomique, les menaces et la dissuasion, la stratégie politique. Les sujets de dissertation sont nombreux et une bonne maîtrise des faits et des enjeux est indispensable pour réussir à les appréhender de façon complète.
Sources : De la coexistence pacifique aux paroxysmes de la guerre froide (1953-1962) - La guerre froide (1945-1989) - CVCE
Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !
Articles liés.

Guide et conseils pour réussir ses révisions et ses examens

Jean de la Fontaine : biographie et oeuvres majeures

Révisions du bac : nos coups de pouce !
Articles récents

Les programmes des différents partis

Classe préparatoire à Sciences Po - Histoire
LAURENT BOSCHER
Sujet 6. Composition : « La Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances »
22 Août 2017 , Rédigé par Laurent Boscher Publié dans #1. SUJETS CORRIGES

Présentation. La Guerre froide désigne la période de l’histoire comprise entre 1947 et 1991, au cours de laquelle le Monde est divisé en deux blocs : d’un côté, le bloc capitaliste allié aux Etats-Unis ; d’un autre côté, le bloc communiste allié à l’URSS. Cette expression, forgée en 1947 par le journaliste américain Walter Lippman, définit la situation de tensions entre les é tats-Unis et l’URSS dans laquelle chacun des deux Grands tente de prendre l’avantage sur l’autre, tout en évitant de déclencher un conflit armé direct entre eux, mais en impliquant parfois un de leurs alliés. Entre 1947 et 1991, en effet, années respectives du refus du plan Marshall par l’URSS et de l’effondrement de celle-ci après 69 ans d’existence (1922-1991), Washington et Moscou, successivement dotés de l’arme atomique depuis 1945 et 1949, adeptes de la dissuasion nucléaire fondée sur l’équilibre de la terreur, s’intimident sans véritablement s’affronter par crainte d’un anéantissement mutuel.
Problématique. La Guerre froide se réduit-elle cependant à un conflit de puissances, mettant aux prises deux nations désireuses de dominer le Monde ? N’est-elle pas avant tout un conflit idéologique opposant deux modèles de civilisation incompatibles ?
Plan. La Guerre froide est un conflit d’une double nature : en premier lieu, un conflit idéologique, opposant le monde capitaliste au monde communiste ; en second lieu, un conflit de puissances, opposant l’armée américaine à l’armée soviétique.
DEVELOPPEMENTS
[I] La Guerre froide est un conflit idéologique (politique), dans la mesure où l’enjeu de ce conflit n’est pas seulement la conquête de territoires (conflit de puissances), il est surtout un conflit opposant deux modèles de société : le modèle américain et le modèle soviétique.
[A] Le modèle américain, que la Maison Blanche entend exporter à travers le Monde, après la défaite des dictatures fascistes (1945), est celui de la démocratie libérale : libérale, d’un point de vue politique, au sens où les citoyens américains choisissent librement leurs représentants lors d’élections pluralistes, généralement organisées tous les quatre ans, afin de désigner les politiciens de droite (républicains) ou de gauche (démocrates), qu’ils jugent dignes de siéger, soit à l’échelon régional à la tête de l’un des 50 Etats qui composent les Etats-Unis, soit à l’échelon fédéral dans le cadre du Congrès (Chambre des représentants, Sénat) ou de la présidence à la Maison Blanche ; mais libérale, d’un point de vue économique également, au sens où les citoyens américains sont libres de travailler, d’entreprendre, d’investir, de vendre, d’acheter, bref de s’enrichir, selon les principes de l’économie de marché et du capitalisme. De fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mode de vie américain ( American way of life ) fait rêver ( American dream ). Tout y est beau, tout y est moderne, tout y est démesuré et, en plus, tout y est accessible en abondance : les maisons individuelles, les gratte-ciel, les voitures, les routes, les moyens de transport, les télévisions, les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs, les chewing-gums, les jeans. Rien ne manque. Au lendemain de la guerre, tout ce qui vient des é tats-Unis est à la mode : le cinéma (Hollywood), la musique (Rock’n’Roll), les idoles (Marilyn Monroe), et même les grandes voitures décapotables (Cadillac). L’Amérique, nouvelle « Terre promise », devient le lieu où tout est possible, en particulier celui des ascensions sociales rapides et des fortunes vertigineuses.
[B] Le modèle soviétique, celui que le Kremlin entend imposer au Monde, offre un autre visage. L’URSS, depuis sa naissance officielle en 1922, cinq ans après la révolution bolchevique d’octobre 1917 accomplie par Lénine et Trotski contre l’Empire russe du tsar Nicolas II, incarne, jusqu’en 1991, année de sa disparition, la patrie de la dictature communiste : dictature, d’un point de vue politique, au sens où les camarades soviétiques ne désignent pas eux-mêmes leurs représentants politiques, un droit réservé aux membres du PCUS, ou alors, quand ils participent à des élections sans véritable enjeu à l’échelon local exclusivement, ils n’ont le choix qu’entre des candidats bolcheviques ; communiste, d’un point de vue économique, au sens où la propriété privée est abolie, la liberté d’entreprendre interdite, les prix autoritairement fixés, les profits proscrits, l’enrichissement illégal, prétexte pris que le capitalisme favorise les inégalités entre riches et pauvres, alors que l’Etat communiste, au contraire, en gérant toutes les entreprises, en payant lui-même tous les salariés du pays, prétend supprimer les injustices sociales. Dans les faits, cependant, au-delà des beaux discours, le niveau de vie est très bas. Les pénuries de biens de consommation courante sont fréquentes. Les rayons des magasins sont vides. Les logements sont inconfortables. Le retard est considérable. Cette paupérisation est d’autant plus mal vécue par la population que les inégalités sociales persistent, notamment entre les apparatchiks communistes membres de la nomenklatura qui s’octroient de plus en plus de privilèges (maisons individuelles, voitures personnelles, magasins privés) et le reste de la population qui, pauvre et démoralisée, sombre dans l’alcoolisme.
[C] Comment, dans ces conditions, le Monde a-t-il pu hésiter entre ces deux modèles ? En premier lieu, parce que les Etats-Unis, un rêve pour certains, est aussi un cauchemar pour d’autres (depuis l’assassinat du président Kennedy en 1963, la guerre du Vietnam du président Johnson en 1964, l’affaire du Watergate du président Nixon en 1974), notamment pour ceux qui ne sont ni riches, ni blancs, ni capitalistes, mais pauvres (pas de sécurité sociale, peu de prestations sociales), noirs (Ku Klux Klan, Martin Luther King, Malcolm X) ou communistes (maccarthysme, chasse aux sorcières, époux Rosenberg). En second lieu, parce que l’URSS, un paradis en théorie, un cauchemar en pratique, masque la réalité de sa situation, soit en invoquant de bons sentiments (la paix dans le Monde, la disparition de la pauvreté), soit en recourant à un vocabulaire trompeur (démocraties populaires), soit en censurant l’information (KGB, procès politiques, Goulags), soit en pratiquant la propagande ( Pravda ), soit en imposant par la force aux pays conquis le modèle communiste (1948, « coup de Prague » en Tchécoslovaquie), soit enfin en entretenant l’illusion de la grandeur (course aux armements, conquête spatiale avec le satellite Spoutnik en 1957 et le cosmonaute Youri Gagarine en 1961).
[Transition] Démocratie libérale, d’un côté, dictature communiste, de l’autre, tels sont les deux modèles de société proposés au Monde au cours de la Guerre froide. L’un des enjeux du conflit pour les deux supergrands consiste donc à faire passer le plus de territoires (continents, pays) sous leur contrôle afin de faire triompher leur civilisation. Voilà pourquoi la Guerre froide, conflit idéologique, est aussi un conflit de puissances.
[II] La Guerre froide est un conflit de puissances (conflit militaire), dans la mesure où l’enjeu du conflit, au-delà du triomphe d’une idéologie sur une autre, consiste, pour les Etats-Unis et l’URSS, à faire passer toujours davantage de pays sous leur influence, leur domination ou leur contrôle, parfois de manière pacifique, d’autres fois en recourant à la force. Ce conflit de puissances a vu le jour en Europe, puis il s’est étendu au reste du Monde, avant de mourir à l’endroit même où il était né, au cœur du Vieux Continent.
[A] La Guerre froide naît en Europe à la faveur de deux événements : le premier survenu en 1946, lors du discours de Fulton, au cours duquel Churchill, ancien Premier ministre britannique, dénonce la division de l’Europe en deux camps, le camp américain et le camp soviétique, hermétiquement séparés par un « rideau de fer », au motif que Staline, oublieux des accords de Yalta (1945), a refusé d’organiser des élections dans les pays libérés de la domination nazie par l’Armée rouge ; le second survenu en 1947, lors du refus du plan Marshall par l’URSS et ses Etats satellites, prétexte pris que cette aide économique américaine, au dire des Soviétiques, serait le moyen astucieux pour les Américains de se rendre à la fois indispensables et populaires auprès de tous les peuples européens. En 1948, seule l’Allemagne, partagée depuis 1945 entre les quatre puissances victorieuses, n’a pas choisi son camp. C’est chose faite, toutefois, en 1949, après l’échec du blocus de Berlin entrepris par l’URSS. En 1949, en effet, l’Allemagne, comme l’Europe, est divisée en deux pays distincts : d’un côté, la RFA, capitaliste, située à l’Ouest ; de l’autre, la RDA, communiste, située à l’Est.
[B] Après 1949, l’Europe entièrement partagée entre les deux superpuissances, le reste du Monde devient le terrain de jeu de la Guerre froide. Les Etats-Unis et l’URSS commencent par s’affronter en Asie : la Chine bascule ainsi dans le camp communiste avec la prise de Pékin par Mao, alors que le Japon, ennemi personnel des Etats-Unis depuis l’attaque aérienne de Pearl Harbor (1941), est élevé au rang d’allié afin d’éviter une nouvelle perte territoriale en Asie ; la Corée, en revanche, après trois années de guerre (1950-1953), est partagée entre les deux camps, la Corée du Nord se rangeant derrière l’URSS, la Corée du Sud derrière les Etats-Unis. Au final, la majorité de l’Asie rejoint le bloc de l’Est, une minorité le bloc de l’Ouest. Après l’Europe au cours des années 1940, l’Asie au cours des années 1950, l’Amérique latine, au cours des années 1960, devient le nouveau théâtre des opérations de la Guerre froide. Cependant, à l’exception notable de Cuba, dirigée depuis 1959 par Fidel Castro, allié de l’URSS lors de la fameuse « crise des missiles » (1962), la majorité de l’Amérique latine soutient les Etats-Unis. Parmi ces pays, de nombreuses dictatures militaires anticommunistes, notamment au Brésil et en Argentine, mais surtout au Chili où depuis 1973 le général Pinochet, auteur d’un coup d’Etat soutenu par la CIA, a chassé du pouvoir un président démocratiquement élu depuis 1970, Salvador Allende, trop proche de Moscou. L’Afrique, enfin, après avoir obtenu son indépendance essentiellement au cours des années 1960, devient à son tour, durant les années 1970, l’objet d’une lutte d’influence entre les Etats-Unis et l’URSS : l’Algérie, la Libye, la Guinée, le Bénin, le Congo, l’Angola, l’Ethiopie, l’Ouganda, le Mozambique et Madagascar rejoignent le camp communiste ; la Tunisie, le Soudan, la Tanzanie, la Zambie restent neutres ; tandis que tous les autres, c’est-à-dire la majorité des pays africains, soutiennent le camp occidental. Aucun continent, désormais, ni plus qu’aucun milieu (terre, mer, air, espace) ou secteur (science, sport, cinéma), n’est épargné par la Guerre froide.
[C] Entre 1989 et 1991, cependant, la Guerre froide, née en Europe dans l’immédiat après-guerre, étendue au reste du Monde au cours des décennies suivantes, s’achève sur le territoire qui l’avait vu naître, l’Europe, à la faveur de deux séries d’événements : d’une part, en 1989, lors de l’effondrement des régimes communistes partout en Europe de l’Est ; d’autre part, en 1991, lors de l’implosion de l’URSS elle-même. L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du Kremlin en 1985, en effet, la chute du mur de Berlin en 1989, la réunification de l’Allemagne en 1990, la chute de toutes les dictatures communistes européennes entre 1989 et 1991 ne donnent d’autre choix aux dirigeants soviétiques que celui de tirer la leçon de l’histoire, conclue par la faillite du modèle communiste et la réussite du modèle capitaliste. Le 25 décembre 1991, après la retransmission télévisée du discours prononcé par le président Gorbatchev, l’URSS est officiellement dissoute. La Guerre froide est terminée.
Fermeture. Entre 1947 et 1991, la Guerre froide a mis aux prises deux pays que tout opposait dans le cadre d’un conflit d’une double nature : conflit idéologique, d’abord, opposant deux modèles de société ; conflit territorial, ensuite, opposant deux superpuissances militaires.
Ouverture. La victoire du camp des démocraties capitalistes sur celui des dictatures communistes annonce-t-elle la fin de l’Histoire, comme l’affirment certains ? N’annonce-t-elle pas seulement la fin d’un monde et la naissance d’un nouveau sur les ruines de l’ancien ? Un monde dans lequel l’ordre planétaire ne serait plus bipolaire, ni même multipolaire, mais exclusivement unipolaire, c’est-à-dire entièrement gouverné par un seul et même pays : les Etats-Unis d’Amérique, grand vainqueur de la Guerre froide ?
A - Le modèle américain (en théorie : le rêve pour tous ; en pratique : le cauchemar pour certains)
B - Le modèle soviétique (en théorie : le paradis pour tous ; en pratique : l’enfer pour l’immense majorité)
C - Un monde partagé entre ces deux modèles (américain, soviétique)
A - Le début de la Guerre froide en Europe (années 1940)
B - L’expansion de la Guerre froide au Monde (années 1950 : Asie ; années 1960 : Amérique ; années 1970 : Afrique)
C - La fin de la Guerre froide en Europe et dans le Monde (années 1980-1990)

- S'abonner au flux RSS http://sciencespodiago.over-blog.com/rss
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
- 25 1. SUJETS CORRIGES
- 20 2. CHAPITRES
- 1 3. AVANT-PROPOS
- 1 4. PRESENTATION
- 1 5. METHODOLOGIE
- 1 6. BIBLIOGRAPHIE
- 1 7. ANNALES
Theme: Classical © 2024 - Hébergé par Overblog

- Voir le profil de Laurent Boscher sur le portail Overblog
- Créer un blog gratuit sur Overblog
- Top articles
- Signaler un abus
- Rémunération en droits d'auteur
- Offre Premium
- Cookies et données personnelles
- Préférences cookies
PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Premiere > Histoire > La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissance
La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissance
Profs en ligne
Vote en cours...
Vous avez déjà mis une note à ce cours.
Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !
Comment as-tu trouvé ce cours ?
Évalue ce cours !
Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile
N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration
Puisque tu as trouvé ce cours utile
Je partage à mes amis
La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :
la majorité des notes est 13.
la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.
il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.
On a obtenu la série statistique suivante :
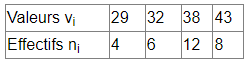
Combien vaut la médiane ?
environ 36,9
On a obtenu la série ci-dessous :
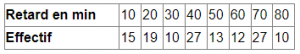
Quelle est la médiane de cette série ?
On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :
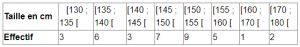
Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?
La classe modale de cette série est [150 ; 155[.
Le mode de cette série est 150.
Le mode de cette série est 9.
Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?
Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !
Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés
Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer
Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours
Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !
Fiches de cours les plus recherchées

De nouvelles conflictualités après la fin de la guerre froide
La dénazification de l'Allemagne et le procès de Nuremberg
La sortie progressive du totalitarisme en URSS
Le partage colonial de l'Afrique à la fin du 19e siècle
L'Empire français au moment de l'Exposition coloniale de 1931
La fin de l'Empire des Indes
Une nouvelle République (1958-1962)
La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880
La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au 20e siècle
Madame Roland, une femme en Révolution
Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés
Espace parents
Quiz interactifs
Podcasts de révisions
Cours en vidéo
Fiches de cours
Merci pour votre inscription
* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .
Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .
- Se connecter à la Digital Toolbox
Déjà enregistré?
Pas encore enregistré, la guerre froide (1945-1989), introduction.
:quality(95):max_bytes(120000)/602fda5192d81405544bb683)
La guerre froide : un monde bipolaire
La guerre froide est le conflit idéologique du XX e siècle. Elle débute en 1947 et s’achève avec la chute du mur de Berlin en 1989, puis l’effondrement du bloc de l’Est en 1991. Le monde est divisé en 2 camps : le bloc occidental autour des Etats-Unis, et le bloc communiste autour de l’URSS. Dans ce dossier, tu vas voir comment, parfois, on a frôlé une nouvelle guerre mondiale.
Les grands épisodes de la guerre froide
Les crises de la guerre froide.
Les guerres de la guerre froide
Berlin, ville symbole de la guerre froide
La course à l'espace.
La fin de la guerre froide
Une nouvelle guerre froide ?
Quiz tes connaissances.
Aucun contenu pour les filtres sélectionnés

Qu'est-ce que la guerre froide ?
Mon Fil Infographie

De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début de la guerre froide
Points de repères
:quality(80):max_bytes(120000)/5e84b5c3f436b8334027c187)
La guerre froide
Les cours Lumni - Collège
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
La guerre froide (1947-1962)
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
Le bloc capitaliste et le bloc socialiste face à face (1962-1975)
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
Un équilibre international fragile (1975-1989)
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
Les groupes d'opposants au communisme dans le bloc soviétique
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3415b988f83e3a2d07e1)
Qu'est-ce que l'OTAN ?
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1020)
L'assassinat de John F. Kennedy
La grande explication
:quality(80):max_bytes(120000)/60cc74cc36e3a56f46435db6)
Sport et guerre froide
Sport et géographie
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
Lexique du monde soviétique
:quality(80):max_bytes(120000)/632ae19734ae14ba10025a97)
Staline refuse le plan Marshall
Apocalypse : la guerre des mondes - 1945-1991
:quality(80):max_bytes(120000)/632b1f6212f69b3ca5041e02)
La guerre froide en 1949 : l'OTAN et la bombe atomique russe
:quality(80):max_bytes(120000)/632c6646f90f6825f70607ff)
1956 : hostilités autour du canal de Suez
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1040)
La crise du canal de Suez
:quality(80):max_bytes(120000)/63348acae3d5033e7b020733)
1961 : le débarquement de la baie des cochons
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1024)
La crise des missiles de Cuba
:quality(80):max_bytes(120000)/632db53223b969f902023eb4)
L'intervention de Kennedy au Vietnam en 1963
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3434b988f83e3a2d0ffe)
Vietnam, la fin de la guerre
:quality(80):max_bytes(120000)/632dbc89eb87a0a7d4095a6f)
Bilan et fin de la guerre du Vietnam
:quality(80):max_bytes(120000)/5df8b84059174a6a5e43e1c2)
Les deux Corées
Géopoliticus
:quality(80):max_bytes(120000)/5f5a6b737386ee258744ad05)
La guerre de Corée
:quality(80):max_bytes(120000)/623c986ca9b10303f07d4285)
Les services secrets soviétiques et américains durant la guerre froide
:quality(80):max_bytes(120000)/63348809edd59710ee034151)
Guerre froide et coexistence pacifique
:quality(80):max_bytes(120000)/632ae5e188766304ac0a7327)
1948 : la montée du communisme et le blocus de Berlin
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
Berlin au cœur de la guerre froide
:quality(80):max_bytes(120000)/616d6c14d101401c6833abc4)
1948 : incidents entre alliés à Berlin
Archives Ina - La guerre froide
:quality(80):max_bytes(120000)/616d6e93ea16b246e54e5f75)
1961 : construction du mur de Berlin - Témoignages d'Allemands séparés
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33f0b988f83e3a2cfdbb)
Les grandes dates de la conquête spatiale
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33b0b988f83e3a2cec6f)
Premiers pas dans l'espace, des V2 à Spoutnik
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae33a7b988f83e3a2ce9f0)
De Youri Gagarine au discours de Kennedy
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3435b988f83e3a2d1007)
Le premier pas sur la Lune
:quality(80):max_bytes(120000)/6168438110b93b2b76165bb3)
La course à l’espace des années 1950 à aujourd’hui
:quality(80):max_bytes(120000)/5dc2efa62055bf150f78323d)
L'effondrement du bloc de l'Est
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae3434b988f83e3a2d1003)
La chute du mur de Berlin
:quality(80):max_bytes(120000)/63344cdc1745c7fc73042ccc)
Mikhaïl Gorbatchev, les derniers jours de l'URSS
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae31a0b988f83e3a2c0975)
1991 : après l'URSS, la naissance de nouveaux Etats
:quality(80):max_bytes(120000)/5dae341eb988f83e3a2d0a0b)
États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?
:quality(80):max_bytes(120000)/627bd8bd02e07142910bdf9a)
Guerre froide : les crises et les conflits
:quality(80):max_bytes(120000)/627bdb7d2c2fe6bf0e0087ac)
Guerre froide : les répressions
:quality(80):max_bytes(120000)/62b96bfe918490a31e0f6157)
1961, construction du mur de Berlin
:quality(80):max_bytes(120000)/627bdb079b1ee36ed400420c)
Berlin, capitale de la guerre froide
:quality(80):max_bytes(120000)/631608086d19d0fa870edf58)
Guerre froide : les JO outils de propagande
:quality(80):max_bytes(120000)/6218bf958129d90ee620f7e8)
Guerre froide : la course à l'espace
:quality(80):max_bytes(120000)/6218be63f4dad17fe54bbe63)
Guerre froide : les hommes de la conquête spatiale
:quality(80):max_bytes(120000)/6218e7d0d7ba7c14a8111d38)
Conquête de l'espace : de Spoutnik 1 à Apollon 11
:quality(80):max_bytes(120000)/6214fcdcf34930076d0695fd)
Fin de la guerre froide : la chute du mur et la réunification de l'Allemagne
:quality(80):max_bytes(120000)/6216346e78561f3e1511b3f5)
Fin de la guerre froide : l'abandon du communisme en Pologne
:quality(80):max_bytes(120000)/621500787d94ab5bc0215a06)
Fin de la guerre froide : l'effondrement de l'URSS

- Je crée mon compte
- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.
Les paramètres de notifications sont bien enregistrés. Tu pourras à tout moment les modifier plus tard dans "Mes notifications"

Reçois les actualités du niveau scolaire qui t'intéresse sur ton application !

- Crises et conflits au XXe siècle
- 5. Dissertations corrigées

- Suivre cet auteur Dominique Mongin
- Dans Crises et conflits au XX e siècle (2014) , pages 105 à 115
Sur un sujet proche
Ce sujet est capital, non seulement dans sa dimension « décolonisation » (avec le départ précipité de la Grande-Bretagne de la région), mais aussi dans le processus de construction d’un nouvel État (Israël), reconnu dès sa naissance par l’ONU, et enfin, et peut-être surtout, par le différend historique entre deux peuples (les Juifs et les Palestiniens), qui récusent toute forme de coexistence, qui était pourtant de mise (bien qu’instrumentalisé) du temps du mandat britannique sur la Palestine. Ce conflit a une résonance d’autant plus grande au début du xxie siècle qu’il n’a toujours pas trouvé de solution et constitue un facteur de tension internationale, qui ne se limite pas aux Proche et Moyen-Orient. Il y a une absence d’unité et de coordination au sein du monde arabe (cf. par exemple le jeu du roi Abdallah de Transjordanie), où prédominent des buts de guerre divergents : La Transjordanie a des visées sur la Cisjordanie et Jérusalem (3e lieu saint de l’Islam). L’Égypte s’intéresse au désert du Néguev. La Syrie rêve d’une « Grande-Syrie » (avec l’accès au port en eau profonde de Haïfa). L’Irak recherche un accès à la mer. Du côté des forces arabes, il existe pourtant une supériorité géostratégique : possibilité d’engager une manœuvre d’encerclement, alors que, du côté israélien, on manque de profondeur stratégique.L’absence de combativité des forces arabes est criante face à la détermination dont font preuve les combattants sionistes, pour qui la survie du nouvel État est en jeu…
- 1. La guerre israélo-arabe (1948-1949)
- Plan de dissertation
- A. La faillite du « front arabe » ?
- a) Un « front » désuni sur le plan stratégique et militaire
- b) Un « front » désuni sur le plan politique
- B. La consolidation d’un nouvel État assiégé
- a) Une nation forgée par un idéal commun
- b) Une stratégie de défense efficace
- C. L’émergence de la question durable des réfugiés palestiniens
- a) Un problème insoluble à court et moyen terme au sein du monde arabe
- b) Un problème « réglé » pour l’État israélien
- 2. La guerre de Corée (1950-1953)
- A. Le 1er conflit militaire de la guerre froide, mais un conflit limité
- a) Un conflit « limité » du fait même de la guerre froide…
- b) …mais une guerre froide qui est confrontée à ses propres limites
- B. Un conflit limité mais aux fortes répercussions régionales au sein des deux Blocs
- a) Le renforcement durable de la cohésion du camp « occidental »
- b) Une cohésion toute relative du camp communiste
- C. Un conflit limité qui a révélé à la fois les potentialités et les limites du système onusien
- a) Les potentialités de l’ONU : succès d’une intervention militaire…
- b) … mais une légitimité de l’ONU remise en cause
- c) La péninsule coréenne est devenue une zone de crises récurrentes héritées de la guerre froide On y observe :
- 3. La guerre du Katanga (1960-1963)
- A. Sécession du Katanga et décolonisation
- a) Les intérêts de la Belgique au Katanga
- b) La réaction du chef de gouvernement congolais
- B. Katanga et guerre froide
- a) Le « jeu » soviétique
- b) Le jeu ambigu des USA
- C. L’interventionnisme de l’ONU en question
- a) Une intervention au nom du respect de la souveraineté d’un État
- b) Les limites de la neutralité onusienne
- c) Une zone d’instabilité chronique en Afrique

- Histoire de la dimension européenne de la doctrine de dissuasion nucléaire française
- Dans L'Europe en Formation 2022/2 (n° 395)
Citer ce chapitre Français
| ISO 690 | FR | MONGIN Dominique, « 5. Dissertations corrigées », dans : , siècle. sous la direction de MONGIN Dominique. Paris, Armand Colin, « 128 », 2014, p. 105-115. URL : https://www.cairn.info/crises-et-conflits-au-xxe-siecle--9782200286484-page-105.htm |
| MLA | FR | Mongin, Dominique. « 5. Dissertations corrigées », , siècle. sous la direction de Mongin Dominique. Armand Colin, 2014, pp. 105-115. |
| APA | FR | Mongin, D. (2014). 5. Dissertations corrigées. Dans : , D. Mongin, siècle (pp. 105-115). Paris: Armand Colin. |
Exporter la citation Français -->
- Version électronique 7,99€
Accès immédiat à la version électronique (par article, HTML et PDF). 7,99€
Mon Cairn.info
Aujourd’hui, Cairn diffuse plus de 400 000 articles de revues et en ajoute 2 500 nouveaux tous les mois. Comment repérer l’essentiel ? Comment ne rien laisser passer ?
Connexion fermée
Vous avez été déconnecté car votre compte est utilisé à partir d'un autre appareil.

01 86 76 13 95
(Appel gratuit)
Cours : La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire
La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire
Si tu es un lycéen en terminale , tu dois déjà avoir planifié tes révisions pour ton baccalauréat 2024 . Si ce n’est pas le cas, tu peux te baser sur notre programme de révision en le planifiant en fonction des dates du bac 2024 ou des coefficients des matières … 💪
Introduction :
Le monde bipolaire qui émerge suite à la Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle forme de conflit, la guerre froide. Chacun des deux Grands (États-Unis et URSS) possède l’arme nucléaire et de nombreux alliés, ce qui garantit qu’une guerre ouverte serait destructrice pour les deux pays et pour le monde. Ainsi, tout en cherchant à déstabiliser et à combattre l’autre camp, les superpuissances évitent de s’affronter directement et préfèrent le faire par pays et mouvements interposés (conflits périphériques). Comment la logique bipolaire de la guerre froide s’impose-t-elle dans les relations internationales ? La plupart des affaires internationales sont réglées de près ou de loin par les Grands et souvent déterminées par l’état de leurs relations. Plusieurs grandes phases se dégagent. À la fin des années 1940 et jusqu’au milieu des années 1950, une forte hostilité existe entre les blocs, qui laisse place à un effort de coexistence pacifique jusqu’à la crise de Cuba de 1962. Celle-ci fait prendre conscience de la nécessité d’une détente, qui reste cependant limitée.
Le début de la guerre froide, une période de fortes tensions (1947-1956)
Les premières années de la guerre froide sont marquées par de très fortes tensions entre les superpuissances, qui se considèrent mutuellement comme une menace.
La lutte pour l’expansion des Blocs
La constitution des blocs se fait de différentes façons, mais passe souvent par l’aide directe ou indirecte des États-Unis ou de l’URSS. Chacun aide ses alliés politiques à prendre le pouvoir.
Le premier conflit périphérique commence en 1950 en Corée. À l’instar de l’Allemagne, elle est divisée entre une zone d’occupation soviétique au nord, devenue la République démocratique populaire de Corée, et une zone d’occupation américaine au sud, devenue la République de Corée. En 1950, les troupes communistes du Nord envahissent le Sud et l’occupent jusqu’à une réaction militaire américaine, autorisée par l’ONU qui condamne l’agression nord-coréenne. Les Américains conquièrent une grande partie de la Corée du Nord, ce qui déclenche une intervention de la République Populaire de Chine. Le conflit est très près de dégénérer en guerre nucléaire, mais le front se stabilise entre Corée du Nord et Corée du Sud, et aboutit à l’armistice en 1953, après un million de morts.

- Les communistes s’imposent également d’autres façons :
- Dans les pays encore colonisés, ils soutiennent la rébellion communiste, comme en Indochine française. Dans cette région, la principale force de résistance est incarnée par le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh .
Viet Minh :
Mouvement indépendantiste et communiste pour la libération de l’Indochine.
- En Europe de l’Est, ils appliquent la « tactique du salami », qui consiste pour les communistes à s’allier aux autres forces politiques avant de les exclure du pouvoir « tranche après tranche, comme un salami » (Mathias Rakosi, dirigeant communiste hongrois). Le « coup de Prague » de février 1948, par lequel les communistes de Klement Gottwald prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie, parachève le contrôle de l’URSS sur l’Europe de l’Est.
- Les États-Unis réagissent via des pactes d’alliance, en aidant à la reconstruction des pays dévastés par la guerre ( plan Marshall ), mais aussi en soutenant les forces opposées aux communistes.
- En France, les ministres communistes sont exclus du gouvernement de Paul Ramadier au printemps 1947.
- En Iran, la CIA (service de renseignement américain) aide au renversement du Premier ministre Mossadegh en 1953, considéré comme trop favorable aux communistes.
En janvier 1953, le président américain Eisenhower (1953-1961) entre en fonction. Il approfondit la doctrine Truman avec la politique du Roll Back (refoulement du communisme), mise en œuvre par son secrétaire d’État John Foster Dulles. Elle s’accompagne d’une conception appelée « théorie des dominos », selon laquelle un pays qui tombe aux mains des communistes risque d’entraîner ses voisins vers le Bloc de l’Est. En réponse à la création et à l’expansion de l’OTAN, l’URSS rassemble ses satellites d’Europe orientale dans le COMECON (Conseil d’Assistance Économique Mutuelle, contrôlant les économies) et le Pacte de Varsovie (alliance militaire dominée par les Soviétiques).
Des sociétés et des modèles opposés
Les États-Unis et l’Union soviétique revendiquent la supériorité de leurs modèles de société respectifs. Les Américains jouissent du meilleur niveau de vie du monde grâce à une économie puissante qui permet l’entrée dans la société de consommation.
Le modèle du libéralisme capitaliste repose sur l’idée que l’individu peut travailler librement dans une société libre pour accéder à l’ American Way of Life , fondée sur le confort matériel et la famille traditionnelle. En URSS, le Parti Communiste contrôle l’économie pour assurer l’égalité matérielle entre tous les citoyens et construire une société communiste sans classes.
Bien entendu, chacun des modèles a son lot de contradictions. Aux États-Unis, si la prospérité est une réalité, elle concerne avant tout les Blancs protestants, car la ségrégation raciale reste en place jusqu’aux années 1960. En URSS, la population est surveillée par un État totalitaire omniprésent . Surtout, le modèle opposé est sans cesse dénoncé et discrédité. En URSS, Staline tombe dans la paranoïa et voit des espions américains partout, comme dans le Complot des Blouses Blanches (ses médecins sont accusés de vouloir l’empoisonner et sont exécutés ou déportés). Aux États-Unis, entre 1950 et 1954 a lieu le maccarthysme (d’après le sénateur Joseph Mc Carthy), une violente campagne de procès et de diffamation envers tous ceux qui sont soupçonnés de la moindre sympathie envers l’URSS.
Une course aux armes et à la technologie
Au tout début de la guerre froide, l’URSS a la plus grande armée du monde mais les États-Unis sont les seuls à disposer de l’arme atomique. Ce monopole prend fin en 1949, quand les Soviétiques acquièrent la bombe grâce à l’espionnage. Si les Américains disposent de nombreuses bases militaires à travers le monde d’où peuvent décoller des bombardiers B-52 munis de bombes nucléaires, les Soviétiques mettent au point des missiles à longue portée capables de frapper en quelques dizaines de minutes.
- C’est ainsi une course aux armements qui s’engage.
Course aux armements :
Durant la guerre froide, augmentation du nombre de bombes possédées par l’URSS et les États-Unis et diversification des moyens de les lancer (bombardiers, missiles, sous-marins, etc.) et de les contrer.
Rapidement, les superpuissances en viennent à une situation de « destruction mutuelle assurée » en cas de conflit. Ainsi, chaque côté craint que l’autre ne décide d’attaquer le premier à la faveur d’un avantage momentané pour augmenter ses chances de victoires. Cette crainte est par exemple attisée en 1957 quand les Américains apprennent que les Soviétiques ont mis en orbite le premier satellite artificiel de l’histoire, Spoutnik. L’intellectuel français Raymond Aron résume cette situation par la formule « paix impossible, guerre improbable » .

Le début de la guerre froide est donc un moment de grande tension, marqué par l’idée d’un affrontement inéluctable. Mais celui-ci ne se produit pas, à la faveur de l’établissement de relations plus apaisées au milieu des années 1950.
La coexistence pacifique (1956-1962)
Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev s’impose en 1956 comme son successeur. Une nouvelle ère s’ouvre dans les relations américano-soviétiques, marquées par une capacité à coexister qui n’empêche pas la persistance de nombreuses occasions de conflit.
Un nouveau contexte politique et stratégique
Staline meurt le 5 mars 1953. Sa succession est marquée par des luttes de pouvoir qui voient la victoire de Nikita Khrouchtchev (premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique de 1953 à 1964).
Le 24 février 1956, au XX e Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique (PCUS), Khrouchtchev dénonce les purges et la terreur de masse du régime stalinien, ce qui ouvre à un relatif assouplissement de l’État policier dans le bloc de l’Est. Mais cette politique de « déstalinisation » est vivement critiquée par la République populaire de Chine, qui prend de plus en plus d’indépendance par rapport à l’URSS dans le camp socialiste.
Ainsi, la bipolarité du monde se réduit : l’unité du bloc de l’Est se fissure, tandis qu’à l’Ouest les États-Unis ne sont plus les seuls à posséder l’arme nucléaire, rejoints par le Royaume-Uni et la France. Surtout, le processus de décolonisation crée de nombreux nouveaux États que chaque Grand tente d’attirer dans son camp. C’est ainsi que la guerre d’Indochine , dans laquelle les États-Unis ont refusé de soutenir la France par opposition au colonialisme, avait abouti en 1954 à la division du Vietnam entre un Nord communiste et un Sud capitaliste.
En 1959, Khrouchtchev expose ainsi les principes de la coexistence pacifique devant le Soviet Suprême (Parlement soviétique) : « Il y a peu de temps encore le feu des passions suscitées par la “guerre froide” était si grand qu’une simple étincelle aurait pu provoquer une conflagration mondiale. La politique étrangère de certaines puissances occidentales était basée sur des calculs nettement agressifs, sur une politique des “positions de force” […]. Actuellement, une évaluation plus sobre de la situation, une compréhension plus raisonnable de l’équilibre des forces sur la scène internationale se manifestent de plus en plus en Occident. Et une telle compréhension des choses conduit inévitablement à la conclusion que les plans prévoyant l’emploi de la force contre le monde socialiste devraient être relégués dans les archives. La vie elle-même exige que les pays ayant des systèmes sociaux différents doivent apprendre à vivre ensemble sur notre planète, à coexister pacifiquement […]. La reconnaissance de l’existence de deux systèmes différents, la reconnaissance à chaque peuple du droit de régler lui-même tous les problèmes politiques et sociaux de son pays, le respect de la souveraineté et l’application du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, le règlement de tous les problèmes internationaux au moyen de pourparlers, voilà ce qu’implique la coexistence pacifique sur une base raisonnable […]. »
Une capacité à coopérer dans le règlement des conflits
L’année 1956 voit les deux superpuissances coopérer pour résoudre une crise internationale autour du canal de Suez . Malgré la décolonisation de l’Égypte (fin du protectorat anglais en 1946), il est toujours possédé par des sociétés britanniques. Or, l’Égypte est contrôlée depuis 1954 par le colonel Gamal Abdel Nasser, qui se revendique non-aligné sur l’un ou l’autre des Grands, et anticolonial. Ce dernier projette de nationaliser le canal de Suez pour financer l’industrialisation du pays. Craignant de perdre le contrôle de ce passage stratégique, les Britanniques planifient une opération militaire de prise du contrôle du canal à laquelle se joignent la France (car Nasser soutient le FLN dans la Guerre d’Algérie) et Israël (qui craint la puissance égyptienne). Nasser nationalise le canal le 26 juillet 1956, déclenchant un débarquement de parachutistes français et anglais ainsi qu’une offensive israélienne dans le Sinaï. En réaction, les États-Unis saisissent l’ONU et commencent à spéculer sur les monnaies européennes. L’URSS envoie un ultimatum à la France et au Royaume-Uni, les menaçant d’utiliser l’arme atomique. Les Français, Britanniques et Israéliens, malgré leur victoire sur le terrain, doivent donc retirer leurs troupes et sont discrédités sur la scène internationale.
- Nasser a transformé une défaite militaire en victoire politique aux yeux des États arabes et du tiers-monde en formation.
Ainsi, cette crise montre l’existence d’un condominium (domination conjointe) américano-soviétique sur le monde, qui peut s’appliquer aux pays hors des deux blocs. Dans le même temps, chaque camp semble respecter la sphère d’influence de l’autre.
Par exemple, en octobre 1956 se produit un soulèvement antisoviétique en Hongrie, mais les troupes du Pacte de Varsovie écrasent l’insurrection de Budapest sans réelle réaction de l’Ouest.
Des rapprochements mais une persistance de la logique de conflit
Des signes de bonne volonté se manifestent de part et d’autre, avec notamment le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis en 1959 ou sa rencontre avec Kennedy à Vienne en 1961.
L’idée de représailles massives en cas de conflit laisse la place à celle d’une riposte graduée.
Cependant la guerre froide continue, comme le montrent les crises autour de Berlin. Après la crise de 1948-1949 (blocus de Berlin) et la proclamation de la RFA et de la RDA , Berlin-Ouest était resté une enclave occidentale dans le bloc de l’Est. Celle-ci sert de vitrine du camp occidental et surtout de point de fuite de la RDA : dans les années 50, plus de 3 millions d’Est-Allemands (en majorité jeunes et qualifiés) fuient le monde communiste en se réfugiant à Berlin-Ouest puis en rejoignant la RFA par avion. Ainsi, Khrouchtchev tente de négocier l’annexion de Berlin-Ouest à la RDA en 1958 mais se heurte au refus catégorique des Occidentaux. Dans la nuit du 13 août 1961, il fait construire un mur entourant hermétiquement Berlin-Ouest.

Ce « mur de la honte » est érigé en symbole de l’oppression communiste à partir de la visite de Kennedy (1961-1963) en 1961, où il prononce un célèbre discours : « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quelle est la grande différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu’ils viennent à Berlin ! Il y en a qui disent qu’en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler avec les communistes. Qu’ils viennent à Berlin ! […] Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n’est pas parfaite. Cependant, nous n’avons jamais eu besoin, nous, d’ériger un mur […] pour empêcher notre peuple de s’enfuir. […] Tous les hommes libres, où qu’ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu’homme libre, je suis fier de prononcer ces mots : « ‟Ich bin ein Berliner !“ »
La détente, un recul maîtrisé des tensions (1962-1975)
La coexistence pacifique est mise à l’épreuve avec la crise de Cuba, qui aboutit à une volonté de réduire activement les tensions de la guerre froide et les dangers de l’équilibre de la terreur. Après une baisse continue des tensions, celles-ci reprennent en 1975.
La crise de Cuba
En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba en chassant le dictateur pro-américain Batista. En juillet 1960, après l’échec d’un voyage diplomatique de Castro aux États-Unis, Che Guevara annonce que Cuba fait partie du camp socialiste. Pour la première fois, la Doctrine Monroe est remise en cause.
Doctrine Monroe :
La doctrine Monroe est formulée au XIX e siècle par le président américain James Monroe (1817-1825). Les États-Unis annoncent qu’ils sont les seuls à pouvoir intervenir dans les affaires de l’hémisphère ouest (continent américain). Pendant la guerre froide, il s’agit d’empêcher l’installation d’un pouvoir pro-soviétique en Amérique Latine.
Les États-Unis établissent donc un blocus naval de l’île, mais l’URSS vient au secours de Cuba en lui apportant une aide économique et militaire. En octobre 1962, les États-Unis se rendent compte que des missiles soviétiques sont en train d’être installés sur le territoire cubain, menaçant leur territoire. Le 22 octobre 1962, Kennedy annonce un ultimatum à Khrouchtchev et exige le démantèlement des missiles et l’arrêt de l’aide militaire soviétique à Cuba. Les tensions montent et font craindre le déclenchement d’une guerre directe, mais Khrouchtchev accepte le retrait des missiles de Cuba en échange du retrait des missiles américains en Turquie. Cette crise montre à tous les besoins d’une détente des relations, ce qui aboutit à la mise en place du « téléphone rouge », pour permettre à la Maison Blanche et au Kremlin de se parler directement.

Désarmement et dégel
La crise de Cuba a montré la dangerosité et la fragilité de l’équilibre de la terreur.
L’équilibre de la terreur a un coût très lourd pour les deux Grands. Une série de traités interdisent les expériences nucléaires dans l’atmosphère, l’espace et l’océan.
En 1968, le Traité de non-prolifération nucléaire voit la plupart des pays renoncer au nucléaire militaire en échange d’une aide au développement du nucléaire civil. La même année s’engagent des négociations sur la limitation des armements nucléaires ( SALT - Strategic Arms Limitation Talk ), finalement signés en 1972. Ils sont immédiatement suivis par les accords SALT II de 1979 qui concernent d’autre types d’armements. Des accords commerciaux sont conclus entre Américains et Soviétiques, aboutissant à un échange de produits agricoles et technologiques américains contre du pétrole et du gaz naturel soviétiques. La détente se manifeste également dans les relations entre pays des deux Blocs. En 1969, le chancelier de la RFA Willy Brandt inaugure l’ Ostpolitik , un rapprochement avec la RDA et les pays d’Europe de l’Est.
Recul de la bipolarité et regel
La bipolarité du monde recule avec l’émergence du tiers-monde (voir le cours Indépendance et nouveaux États pendant la guerre froide ), et principalement de la Chine populaire, proclamée en 1949. Malgré la rupture sino-soviétique des années 1950, l’Ouest continuait de ne pas reconnaître la République populaire de Chine (voir le cours : L’ère Maoïste : retrouver la puissance par la révolution (1949-1979) ). En effet, les Occidentaux reconnaissent le gouvernement de Taïwan comme étant la véritable République de Chine.
Les choses changent en 1971 avec la visite en Chine d’Henry Kissinger, conseiller à la Sécurité nationale du président Nixon (1969-1974), dans le cadre d’une « stratégie triangulaire » qui permettrait de diviser le bloc de l’Est. C’est ainsi que la RPC est admise à l’ONU comme membre permanent du Conseil de Sécurité (avec droit de veto), à la place de Taïwan.
La fin des années 1960 voit surtout une remise en cause des modèles bipolaires à travers le monde, obligeant les Grands à se remettre en cause. La détente américano-soviétique culmine avec les Accords d’Helsinki de 1975. Ceux-ci reconnaissent l’inviolabilité des frontières européennes, prévoient de continuer la coopération commerciale, scientifique et technologique et contiennent des engagements en matière de droits de l’homme. Cependant, ces accords sont suivis d’une prise de conscience que la guerre froide continue par d’autres moyens et dans d’autres régions, notamment en Afrique. Ainsi, après les années dites du « dégel » vient le temps du « regel » des relations américano-soviétiques.
Conclusion :
La guerre froide commence donc par une période de forte défiance mutuelle qui accélère la bipolarisation du monde. Celle-ci est marquée par un affrontement des Grands par pays interposés en de nombreuses régions du monde. L’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev en 1956 permet d’envisager une coexistence pacifique et une résolution commune des crises, comme le montre la Crise de Suez. Les tensions restent réelles, comme le prouve la crise de Cuba, mais la détente permet de préserver la paix, jusqu’au retour d’une forte défiance mutuelle en 1975.

- Archives du BAC (43 529)
- Art (11 061)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 453)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 268)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 543)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 435)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Archives du BAC
- / BAC Histoire - Geo
La Guerre Froide
Par Léa Jacquiot • 1 Décembre 2018 • Dissertation • 1 668 Mots (7 Pages) • 566 Vues
DM Histoire : La Guerre Froide
Sujet 1 : Composition :
La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances
Les deux Guerres mondiales ont débouché sur un désir de mettre en place un Monde en paix. Cependant, les espoirs ont été rapidement déçus. En effet, très vite après la Seconde Guerre Mondiale, les deux Grands vainqueurs : les Etats-Unis et l’URSS s’opposent et rentrent dans une nouvelle ère de combat. La Guerre Froide débute ainsi dès 1947 et rapidement se met en place un monde bipolaire où chaque pays choisit son "camp". L’implosion de l’URSS en 1991 met un terme à cette guerre de type nouveau, qui aura tout de même séparée le Monde durant 44 ans. En quoi la Guerre Froide est-elle un conflit original ? Tout d’abord, nous verrons que cette Guerre repose sur l’affrontement planétaire de deux idéologies bien distinctes, puis dans un second temps nous montrerons qu’elle équivaut à un conflit de puissances, équilibré par la menace nucléaire.
Dans un premier temps, l’URSS et les Etats-Unis sont les deux grands pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On peut leur observer dès lors une volonté de jouer un rôle majeur dans le monde post-guerre. En effet, deux idéologies diamétralement opposées s’affrontent. Le modèle Américain repose sur un système capitaliste et libéraliste, qui prône la liberté : c’est une démocratie . Le système soviétique est plutôt basé sur une valeur d’ égalité . L’URSS éprouve donc une volonté de « gommer » les inégalités et ainsi de faire disparaître les classes sociales. Sur le plan politique, il y a la dictature du Prolétariat, c’est-à-dire des ouvriers, ainsi qu’un parti unique. Sur le plan économique, c’est l’Etat qui réquisitionne et possède tout les moyens de production (collectivisation), et qui décide de la politique à mener. Ainsi, les « deux Grands » cherchent à diffuser leurs valeurs et idéologies respectives afin de servir de modèle pour le reste du monde. Pour cela, dès 1946, l’Europe est coupée en deux par ce qu’appelle Churchill, « le rideau de Fer », avec à l’Est une influence soviétique. L’année suivante, se met en place un monde dit « bipolaire », c’est-à-dire séparé en deux blocs, avec une partie soviétique et une partie occidentale. Berlin est un symbole de ce monde divisé, avec la capitale, grande puissance du pays, séparée en deux par un mur en 1961 et illustrant ces deux camps. Berlin apparaît alors comme le microcosme d’un monde bipolarisé et d’une Europe fracturée. Truman, le président Américain, met alors en place « l’endiguement », qui vise à stopper l’extension de la zone d’influence soviétique et à contrer les Etats susceptibles d’adopter le régime communiste, avec le « plan Marshall » qui est une aide financière post-guerre accordée aux pays d’Europe, puisque selon lui les difficultés économiques favorisent les partis extrémistes et totalitaires. Ainsi, les pays qui acceptent se voient en contrepartie l’obligation d’adhérer à l’idéologie démocratique/capitaliste, et les Etats-Unis auront prêté en tout plus de 13 milliards de dollars. S’en suit à cela une riposte idéologique de l’URSS qui met au jour la « doctrine Jdanov », qui accuse les Etats-Unis de vouloir étendre son pouvoir et sa puissance afin de dominer l’Europe. Ainsi, cette doctrine affirme la division du monde en deux camps : les « forces impérialistes », dirigées par les États-Unis, et les « pacifistes », menées par l'URSS. Il y a également la création du « Kominform », qui correspond à la mise en commun des partis communistes dirigés par l’URSS. Le bloc occidental se structure donc principalement autour des Etats-Unis, et les 16 pays ayant acceptés le plan Marshall, forment l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique) chargée de répartir l’argent des Américains. De plus, une des principales armes de cette guerre est la propagande. En effet, il s’agit pour chacun de "conquérir " les opinions publiques. Chaque camp entend d’une part promouvoir, diffuser et vanter son modèle et d’autre part ternir, accuser et dénoncer l’idéologie adverse. Les médias et les discours sont des outils majeurs de ce procédé. Par exemple, les télévisions Occidentales vantent le rôle de sauveurs joués par les Etats-Unis lors du blocus de Berlin en 1949. Ainsi, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Terre se voit séparée en deux visions du monde et en deux projets pour son avenir qui sont irréconciliables et portées par deux superpuissances rivales, mais pourquoi cela n’a-t-il pas dégénéré en troisième guerre mondiale ?
Dans un second temps, en plus de ce monde divisé en deux idéologies, les Américains mettent rapidement en place des alliances militaires, avec notamment la création de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) en 1949 qui regroupe l’Europe de l’Ouest, le Canada et les Etats-Unis. Ce pacte est une alliance militaire défensive, c’est-à-dire que si l’un des pays membres est attaqué, les autres doivent rentrer en guerre et l’aider. Il y a également l’OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est), pacte militaire pro-occidental mis en place en 1954 et regroupant des pays Asiatique non communistes. Enfin, nous avons le Pacte de Bagdad crée en 1955 par l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran et le Royaume-Uni. Les États-Unis rejoignent le comité militaire de l'alliance en 1958. Mais de son côté, l’URSS structure aussi son bloc. En effet, en 1955 est mis en place le Pacte de Varsovie, alliance militaire (pacifique) semblable à l’OTAN, ainsi que le CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle) crée en 1949 qui unie les économies de l’Europe de l’Est et d’URSS. Mais le bloc soviétique trouve également des relais dans le Tiers-Monde comme la Chine en 1945 ou Cuba en 1959. Ainsi, par ces différentes coalitions, on peut voir que chaque camp cherche à se protéger d’une éventuelle agression de son rival, qui débouche sur une véritable course à l’armement, aussi bien conventionnel que nucléaire. En effet, les Deux Grands possèdent l’arme nucléaire, et son utilisation par l’un de ces pays aurait amené à une destruction mondiale. La formule de Raymond Aron selon laquelle la Guerre Froide serait "une paix impossible, mais aussi une guerre improbable" explique l’idée qu’ils évitent d’aller trop loin et qu’ils cultivent ainsi ce qu’on appelle "l’équilibre de la terreur". De plus, en fonction de la conjoncture internationale et des problèmes que peuvent rencontrer les Etats-Unis ainsi que l’URSS, la Guerre Froide alterne des périodes de tension ou bien d’apaisement. En effet, la période allant notamment de 1947 à 1953 (mort de Staline) est fortement tendue puisque se déroulent la guerre de Corée entre 1950 et 1953 et la première crise de Berlin de 1948 à l’année suivante. La guerre Coréenne appuie une fois en encore sur cette idée de guerre de puissance, indirecte, puisque qu’elle oppose la Corée du Sud soutenue par les Etats-Unis, et la Corée du Nord sous influence soviétique. De plus, la crise Berlinoise amène également à la création de deux Allemagnes : d’un côté la RFA (République Fédérale Allemande), capitaliste et sous l’influence des Etats-Unis, et de l’autre la RDA (République Démocratique Allemand) qui se trouve dans le camp soviétique. Cette crise met en place les règles de la Guerre Froide, c’est-à-dire l’intimidation par la propagande, mais pas de confrontation directe. Ensuite, se déroule une période de coexistence plus ou moins pacifique de 1953 à 1962. En effet, Khrouchtchev, successeur de Staline, souhaite améliorer les relations Est-Ouest et diminuer le retard économique marquant avec les Etats-Unis, notamment dû à cette course à l’armement. Malgré cette tentative russe, les tensions demeurent avec la crise de Cuba en 1962 et avec la création du Mur de Berlin en 1961. Plusieurs autres périodes se sont déroulées ensuite, mais au final, il n’y a pas réellement de période de "détente ", puisqu’elles connaissent tout de même des crises, des tensions ou bien des guerres. Il faudra attendre celle allant de 1985 à 1991 puisqu’elle marque le début de l’effondrement du bloc soviétique. En effet, le nouveau dirigeant russe Gorbatchev constate en 1985 que le monde communiste ne fonctionne pas et il souhaite ainsi en finir avec "la course aux armements " pour résoudre définitivement les difficultés économiques de son pays. Le président Américain Reagan accepte cette "main tendue ". L’URSS étant trop mal en point, cette dernière implose en 1991, les pays qui la composent deviennent indépendants, puis elle disparaît.

- Profil et compte
- Se déconnecter
Guerre froide : causes, développement, dates... Résumé du conflit

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines encore fumantes de l'Europe et de l'Asie, la tension monte soudainement entre les Etats-Unis et l'URSS. Le camp Allié, dont l'ennemi commun a été éradiqué, se disloque en l'espace de quelques mois. Pendant 40 ans, la menace d'une Troisième Guerre mondiale plane sans jamais se concrétiser. C'est la Guerre froide : un conflit qui s'étend de 1946 à 1991. Celui-ci oppose deux systèmes irréconciliables : le capitalisme libéral et démocratique, emmené par les Etats-Unis, et un système communiste, souvent qualifié de "totalitaire", conduit par l'URSS.
De 1946 à 1949, vers un monde bipolaire
Dès 1946, forte de sa victoire en Europe centrale et du prestige de l'Armée rouge, l'URSS s'impose dans les pays libérés. De leur côté, les Etats-Unis cherchent à "endiguer" le communisme, qu'ils considèrent comme incompatible avec le libéralisme. L'Europe de l'ouest se range dans leur camp. En trois ans, le monde connait une escalade des hostilités qui se traduit par des conflits armés. Mais, alors que chacun craint la Troisième Guerre mondiale, le monde va être ponctué de crises périphériques aux deux nations sans jamais que celles-ci ne se déclarent la guerre.
Les causes de la guerre froide et l'incompatibilité idéologique
La fracture entre les Etats-Unis (ainsi que les démocraties européennes) et l'URSS ne surgit pas inopinément en 1946. Elle remonte en fait à la naissance même de l'URSS. Depuis la révolution russe de 1917 et l'arrivée au pouvoir de Lénine , les deux pays souffrent d'une véritable "incompatibilité idéologique". D'un côté, les Etats-Unis s'affichent comme les représentants du libéralisme , tant politique qu'économique, tandis que de l'autre, l'URSS fustige le capitalisme et prône une société sans classe, où les initiatives de l'individu s'effacent devant les intérêts du peuple. En ce sens, la Grande Alliance peut être perçue comme une parenthèse nécessaire pour affronter le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce rapprochement ne fut d'ailleurs pas évident, puisque Staline , face à l'absence de soutien des Occidentaux, avait signé en 1939 un accord de non-agression avec Hitler , le pacte germano-soviétique.
Cependant, au cours des années 1920 et 1930, le contexte est très différent de celui de 1946, et ce pour plusieurs raisons. De 1919 à 1922, l'Europe est bousculée par le Komintern (ou Internationale communiste), l'appel à la révolution mondiale prononcé par Lénine et les insurrections ouvrières. Mais ces insurrections se traduisent par des échecs. Ensuite, l'URSS doit avant tout faire face à ses difficultés intérieures et à l'état catastrophique de son économie. Et après 1922 et conformément à la doctrine Monroe énoncée en 1823, les Américains se refusent à toute intervention en Europe et limitent leur domaine d'influence au continent américain. Ce mouvement de repli est d'ailleurs renforcé par la crise de 1929 . Ainsi, après 1922, pendant l'entre-deux guerres, chaque camp reconnaît en l'autre un ennemi, mais sans jamais aller jusqu'à la confrontation.
Les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale
En 1946, le contexte a changé. L'Europe, ravagée par la guerre, a perdu sa puissance et son faste. Elle doit s'atteler à sa reconstruction. Par ailleurs, les empires coloniaux français et anglais sont en perte de vitesse. L'URSS , qui a énormément souffert de la guerre, se relève avec un prestige immense en Europe, car c'est finalement elle qui a libéré le plus de territoires du joug nazi. Les Etats-Unis , malgré l'effort de guerre, sortent économiquement renforcés et ont montré à l'URSS leur supériorité militaire en lançant la bombe atomique sur le Japon. Face à la victoire totale sur les forces de l'Axe et à la faiblesse de l'Europe, les Etats-Unis et l'URSS, alors encore alliés, sont deux grandes puissances en mesure de dominer le monde.
La tombée du "rideau de fer"
Dans ce contexte, une multitude d'éléments explique les tensions croissantes entre ce qui va devenir les "deux blocs". Longtemps, l' historiographie de chaque camp renvoyait la faute sur l'autre : ainsi, pour les Occidentaux, la Guerre froide serait due au non respect des accords de Yalta . En effet, Staline n'a pas permis la tenue d'élections libres (au sens où l'entendent les Européens) dans les Etats libérés par l'Armée rouge. De son côté , l'URSS retient la politique ouvertement anti-communiste de Truman , la doctrine du containment (endiguement). En réalité, ces causes s'imbriquent et il est difficile d'attribuer une responsabilité à un camp plus qu'à l'autre.
Avant la fin de la guerre, Churchill et Staline pensent déjà en terme de zone d'influence. C'est ainsi que, dès octobre 1944, les deux hommes font chacun des concessions quant aux territoires dans lesquels ils pourront intervenir. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, il ne s'agit pas à proprement parler d'un "partage de l'Europe". En effet, il s'agit moins de s'approprier un pays ou d'en déterminer les frontières que de se mettre d'accord sur le soutien apporté à tel ou tel régime. Ainsi, Staline s'engage à ne pas soutenir les communistes grecs et yougoslaves tandis que Churchill n'aidera pas les libéraux hongrois et roumains.
Mais en 1945, les accords de Yalta remettent en cause cette entente en affirmant le droit des pays libérés aux élections libres et démocratiques. La conception des élections libres de Staline n'est pas celle de Truman. Rapidement, les Partis communistes nationaux occupent une place centrale dans les pays de l'Est et les élections sont truquées. Churchill, qui s'inquiète de cette situation depuis 1945, prononce en 1946 le discours de Fulton, où il dénonce le rideau de fer qui scinde désormais l'Europe . Si Churchill n'est plus Premier ministre à cette époque, son discours a un énorme retentissement. La rupture entre le "monde libre" et "le monde communiste" n'est plus un secret.
La doctrine Truman aux Etats-Unis
Dès 1944, les Américains préparent leurs armes économiques avec les accords de Bretton Wood. Si ces mesures visent l'Axe, elles ouvrent la voie pour le volet économique de la doctrine Truman. Face à la situation qui se dégrade en Europe centrale, le président américain Harry Truman décide de mettre en place sa politique de containment (endiguement). Il annonce le 12 mars 1947 sa vision d'un monde scindé en deux camps opposés et irréconciliables. A la tête du "monde libre", opposé au communisme, les Etats-Unis prennent rapidement la tête d'initiatives politiques, économiques et militaires qui ont pour but d'empêcher l'expansion du communisme.
Le plan Marshall aux Etats-Unis
Le plan Marshall est proposé dès le 5 juin 1947 . Ses objectifs sont multiples, comme aider financièrement l'Europe pour empêcher la pauvreté de s'installer, terrain qui serait favorable au communisme, et permettre à l'économie des Etats-Unis qui a été modifiée pendant la guerre, de se maintenir à un bon niveau grâce aux exportations vers l'Europe. Les Etats-Unis aident l'Europe qui, avec ces capitaux, peut ainsi acheter des produits américains. Si Truman déclare dans son discours que la politique des Etats-Unis "n'est dirigée contre aucun pays ni doctrine", la mise en œuvre du plan scinde définitivement l'Europe en deux. D'un côté, les pays occidentaux acceptent, et s'organisent en créant l'OECE, qui jette les bases de la future construction européenne. Les pays de l'autre côté du rideau refusent, parfois sous la contrainte de Moscou.
Le rapport Jdanov en URSS
L'URSS répond au containment et au plan Marshall avec le rapport Jdanov, dès septembre 1947 : celui-ci fustige "l'impérialisme américain" et présente l'URSS comme le leader des "pays démocratiques". Elle met par ailleurs en place le Kominform qui est chargé de contrôler l'orthodoxie des PC nationaux. Moscou réplique au plan Marshall en 1949 en instaurant le Conseil d'assistance économique mutuelle (le CAEM ou COMECON en anglais), institution chargée de mieux planifier les spécialités industrielles nationales. Cette mesure rend les pays communistes très dépendants les uns des autres, mais surtout de l'URSS. Symboles de cette lutte, les communistes des gouvernements de l'Europe de l'ouest (France, Italie) sont dans une position délicate : pour les démocrates, ils ne sont plus les bienvenus, et pour le Kominform, leur participation à un régime occidental est synonyme de trahison. Ils désertent alors l'exécutif et se rangent dans l'opposition.
Les deux blocs s'établissent
En l'espace d'un an, les tensions latentes se sont transformées en une opposition frontale. Le divorce est consommé entre les membres de la Grande Alliance. Les deux années suivantes prolongent les actions engagées, tandis que les hostilités suivent le rideau de fer. Le processus économique mondial engagé par les Etats-Unis à Bretton Woods et par le plan Marshall franchit un nouveau pas avec les accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Ancêtre de l'OMC, cet accord signé par 83 pays et entrant en vigueur dès janvier 1948 instaure le libre échange à l'échelle mondiale.
Le coup de Prague en 1948
De son côté, Staline renforce son contrôle sur les territoires d'Europe centrale libérés par l'Armée rouge. Cette domination est symbolisée par le coup de Prague le 25 février 1948 . Après avoir dû abandonner les aides du plan Marshall, le président tchécoslovaque Beneš est victime d'un véritable coup d'Etat communiste. Seul pays d'Europe centrale à avoir une véritable tradition démocratique avant la guerre, la Tchécoslovaquie entre dans le cercle des démocraties populaires. Ce coup de force participe à une escalade des tensions Est-Ouest, qui laisse penser qu'une Troisième guerre mondiale est imminente.

La création de l'OTAN
Ainsi, dès le mois de juillet, les pays de l'Europe de l'ouest se retrouvent à Washington pour un accord militaire hors du cadre de l'ONU. C'est alors qu'est décidée la création de l'Alliance Atlantique et de son pendant militaire, l'OTAN . Celle-ci prend véritablement naissance en avril 1949 . A ce titre, la réaction de l'URSS est assez tardive puisque le pacte de Varsovie n'est créé qu'en 1955. Mais l'Armée rouge, dont la progression face aux nazis a suffi pour donner une idée de sa puissance, est encore stationnée un peu partout en Europe centrale. Dès lors, maintenant que les acteurs sont prêts, c'est la phase la plus aiguë de la Guerre froide qui commence, celle des crises et des conflits périphériques. D'autant plus qu'une nouvelle région de crise apparaît après la victoire du Parti communiste de Mao , en octobre 1949, en Chine. Mais, parallèlement à cette tension, un nouveau facteur d'équilibre entre en jeu : la maîtrise de l'arme nucléaire par l'URSS, due essentiellement à un excellent service d'espionnage. La Grande Alliance contre les forces de l'Axe n'a survécu qu'un an à la défaite de l'Allemagne et du Japon.
De 1949 à 1953, l'apogée de la Guerre froide
Depuis 1945, l'espoir né de la victoire des Alliés sur les nazis a peu à peu laissé place à une opposition entre le communisme et le libéralisme. Les deux principales puissances alliées s'opposent sur la politique à appliquer dans les territoires libérés. D'où les appellations de bloc de l'est , regroupant les démocraties populaires européennes derrière l'URSS, et de bloc de l'ouest , regroupant les démocraties européennes alliées aux Etats-Unis. Le vieux continent est traversé par le rideau de fer , selon l'expression de Churchill, qui dénonce dès 1946 l'absence de transparence des Soviétiques en Europe de l'est. Mais le conflit s'étend rapidement en Asie, notamment après la victoire des communistes dans la guerre civile chinoise. Durant quatre ans, la tension est à son paroxysme, notamment à Berlin et en Corée, jusqu'à la mort de Staline.
Le blocus de Berlin durant la guerre froide
Après le coup de Prague le 25 février 1948, toute l'Europe centrale et orientale est gouvernée par les régimes communistes, tandis que l'Europe occidentale se range du côté des Etats-Unis et cherche à préserver son système démocratique. L'Allemagne, et dans une moindre mesure l'Autriche, occupées par les Alliés, deviennent rapidement les enjeux de la lutte d'influence entre URSS et Etats-Unis. A l'ouest, Américains, Britanniques et Français décident d'accélérer le redressement économique de l'Allemagne. C'est, selon eux, le meilleur moyen de faire barrage au communisme et de favoriser la réconciliation entre l'ex-Allemagne nazie et ses voisins. Ainsi, sans consulter l'URSS, ils décident de fusionner leurs zones d'occupation et de créer une nouvelle monnaie, le Deutsch Mark . A terme, l'objectif est l'indépendance politique du pays, quitte à le séparer de la zone soviétique.
Staline réagit vivement à cette décision en organisant le blocus de Berlin : toutes les voies ferrées et routières reliant Berlin-ouest à la zone occidentale sont coupées. En effet, aucun accord n'assure la libre circulation des occupants de la zone ouest sur le territoire de la zone soviétique. Mais pour les Occidentaux, il n'est pas question d'abandonner Berlin aux Soviétiques. C'est pourquoi ils organisent rapidement un pont aérien , dont la légitimité est en revanche garantie par le traité d'occupation. Jusqu'au 12 mai 1949, des milliers de vols permettront le ravitaillement des Berlinois.
Après presque un an, Staline cède et lève le blocus , mais la rupture entre les occupants est consommée. Dès le 25 mai, la zone d'occupation occidentale devient la RFA . Quelques mois plus tard, en octobre, l'URSS répond en créant la RDA . Les accords de Potsdam , rompus par les Occidentaux lors de la fusion des zones, n'ont désormais plus cours. L'Allemagne reste pendant des années le symbole de la lutte d'influence entre l'ouest et l'est. Les Américains prônent dès 1950 son réarmement. Passant par le projet de Communauté européenne de défense (la CED), ce réarmement se heurte à de vives polémiques, notamment en France. Zone occupée, mais bénéficiant d'un gouvernement autonome, l'Autriche échappe en revanche à ces conflits.
La crise sur le terrain asiatique
Bien que soutenus par les Etats-Unis, les nationalistes chinois s'inclinent en 1949 face aux communistes menés par Mao . L'arrivée au pouvoir de ce dernier bouleverse la géopolitique asiatique. En effet, la domination japonaise durant la guerre a fortement contribué à l'émergence ou au renforcement des revendications nationalistes, qui ont souvent l'appui (formel ou concret) des Etats-Unis. Mais les communistes sont très actifs dans les combats et disposent désormais avec la Chine d'un soutien de masse. Ne désirant pas voir les pays communistes se multiplier en Asie, les Etats-Unis révisent alors leur diplomatie. Cela les convainc notamment d'aider financièrement la France dans la guerre d'Indochine . Mais les événements les plus dangereux pour la paix mondiale se déroulent lors de la guerre de Corée , dans laquelle les deux puissances ne peuvent s'empêcher d'intervenir.
Pour beaucoup d'historiens, le règlement du conflit a été facilité par la mort de Staline le 5 mars 1953 . La guerre froide a atteint son apogée lors de la guerre de Corée et le règlement du conflit annonce une détente. Il est fort probable que le changement de personnalité à la tête du pays ( Eisenhower succède à Truman à la présidence des Etats-Unis la même année) ait contribué à cette inflexion des relations diplomatiques entre les deux pays. En Asie, cette guerre a aussi pour conséquence l'accélération du redressement du Japon : comme avec la RFA, les Etats-Unis souhaitent un Japon prospère et allié, qui puisse résister à la Chine et à l'URSS. En 1951, le traité de San Francisco définit les conditions de la fin de l'occupation et de l'indépendance. Les Etats-Unis souhaitent aussi accélérer une remilitarisation partielle du pays. Cette volonté se traduit par la signature d'un traité d'assistance militaire en août 1953.
La guerre idéologique à l'intérieur
Les tensions de la guerre froide ne se manifestent pas uniquement sur le terrain international, elles se traduisent également par des troubles en terme de politique intérieure, en URSS et aux Etats-Unis. En URSS, Staline renforce depuis 1939 son pouvoir et le culte de la personnalité . L'idéologie se durcit. A partir de 1948-1949, ce mouvement subit une nouvelle accélération. En 1952, Staline annonce qu'il souhaite opérer quelques modifications dans le fonctionnement des institutions. Mais surtout, au début de l'année 1953, il fait dénoncer par la Pravda le complot des blouses blanches . Le procès annonce une nouvelle purge s'attaquant aux juifs, aux intellectuels et aux cadres des institutions. Il est dénoncé par Khrouchtchev après la mort de Staline, et les victimes sont réhabilitées.
Mais la guerre idéologique de l'intérieure n'est pas une exclusivité soviétique. Les Etats-Unis cèdent également à la théorie du complot avec le maccarthysme , également appelé " Chasse aux sorcières " ou "Terreur rouge". Là aussi, les moyens mis en œuvre sont politico-judiciaires. En 1938, puis en 1947, les Etats-Unis ont mis en place et favorisé l'action d'un comité visant à repérer et surveiller les ennemis des Etats-Unis. Mais en 1950, les événements prennent une nouvelle tournure lorsque le sénateur McCarthy dénonce la présence de communistes dans l'administration américaine. La maîtrise de l'arme nucléaire par les Soviétiques depuis août 1949 renforce les peurs américaines. Le climat de suspicion est entretenu par le procès Rosenberg , et surtout lorsque McCarthy obtient un poste d'influence en 1952. Sa commission, qui se contente souvent de doutes pour mettre en accusation, aboutit à de nombreuses accusations, démissions et révocations dans la fonction publique. Des personnalités d'Hollywood font même le choix de l'exil. Ce climat s'apaise à partir de 1954, lorsque McCarthy met en cause des personnalités militaires de premier ordre, perdant ainsi brusquement toute crédibilité.
De 1953 à 1962, la coexistence pacifique
La fin des années 1940 et le début des années 1950 marquent l'apogée de la guerre froide. La guerre idéologique bat son plein tandis que les sphères d'influence se structurent à l'échelle mondiale. Mais l'impasse de la guerre de Corée incite les belligérants à plus de prudence : c'est l'équilibre de la terreur. Tandis que Khrouchtchev prend la suite de Staline et Eisenhower celle de Truman, le conflit entre dans une nouvelle phase : la coexistence pacifique . Malgré quelques accrocs, les zones d'influence de chaque bloc sont établies pour des années.
Déstalinisation et volonté de dégel à l'Est
L'année 1953 marque un tournant au sein de la guerre froide : la guerre de Corée s'achève et l'URSS entre dans une phase de " déstalinisation ", tandis qu'Eisenhower, bien que sans complaisance envers le communisme, souhaite la paix. C'est le début du dégel, de la coexistence pacifique entre les deux nations, c'est-à-dire d'une période où chacun reste hostile à l'autre tout en refusant l'escalade des tensions. La mort de Staline, puis l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev en septembre 1953, modifient considérablement la politique intérieure et extérieure de l'URSS. Le nouveau dirigeant soviétique décide de rompre avec la stratégie de son prédécesseur, qui s'est éloigné de plus en plus des idéaux bolcheviques développés par Lénine .
Sa politique prend tout son sens en 1956, année où il profite du XXème Congrès du PCUS pour présenter un rapport secret. Il y développe deux théories majeures pour la gouvernance du pays. Tout d'abord, il accable l'ère stalinienne, dénonçant les abus, le culte de la personnalité ou encore les erreurs commises lors de la Seconde Guerre mondiale. Le nouvel homme fort du bloc communiste, qui avait mis un terme aux purges du "complot des blouses blanches" dès 1953, change considérablement l'image et le fonctionnement du régime. La censure se relâche et le goulag est réformé pour plus de justice, jusqu'à y perdre son nom. C'est la déstalinisation. Khrouchtchev expose ensuite sa doctrine de coexistence pacifique, caractérisée par la non-agression, la non-ingérence et la possibilité de coopération économique avec les Etats-Unis. Le capitalisme est toujours désigné comme l'ennemi impérialiste, mais la guerre n'est plus inévitable. L'insurrection hongroise montre les avancées et les limites de la politique de Khrouchtchev.
Le tiers-monde entre en jeu
Après l'armistice du 23 juillet 1953 en Corée, la situation politique en Asie demeure problématique, notamment à cause de la Guerre d'Indochine . La situation des Français est très difficile, puis catastrophique après Diên Biên Phu. La déroute de l'armée française s'est accompagnée d'un refus des Etats-Unis de s'investir dans le conflit. La situation aboutit finalement le 21 juillet 1954 aux Accords de Genève, qui reconnaissent l' indépendance de l'Indochine . La géopolitique mondiale connaît rapidement un bouleversement. Grâce aux victoires des indépendantistes dans les guerres de décolonisation, comme en Indochine, une nouvelle force émerge et se réunit à Bandung : le tiers-monde . La conférence des non-alignés se tient du 18 au 24 avril 1955 en Indonésie et est l'occasion pour des personnages comme Nasser ou Nehru de s'affirmer sur la scène internationale. Les pays représentés condamnent le colonialisme et affirment haut et fort leur volonté de ne se fondre dans aucun des deux blocs. Ils se présentent comme une troisième force.
L' affaire du Canal de Suez illustre ce réajustement à la fin de l'année 1956. Lorsque la France, l'Angleterre et Israël attaquent l'Egypte pour éviter la nationalisation du canal de Suez, ils sont rappelés à l'ordre à la fois par les Etats-Unis et l'URSS. Ils doivent alors céder à Nasser. Ainsi, le tiers-monde obtient sa première victoire, tandis que les Etats-Unis et l'URSS démontrent leur volonté de conserver un certain statu quo concernant les zones d'influence. L'humiliation ressentie par la France et l'Angleterre prouve que l'Europe n'est désormais plus en mesure de s'imposer dans le monde face aux deux super puissances. L'Europe est d'ailleurs le théâtre d'un nouveau drame en 1956, lors de l' Insurrection de Budapest . En octobre et en novembre, la ville se révolte contre la présence soviétique et le gouvernement communiste. Face à cette situation, Khrouchtchev montre les limites de la déstalinisation : il envoie ses troupes réprimer le soulèvement dans le sang. Ni les démocraties européennes, ni les Etats-Unis ne réagissent : le respect des zones d'influence propre à la coexistence pacifique est alors une réalité.
La course à l'armement nucléaire
Paradoxalement, la relative détente des relations internationales entre les deux grands s'accompagne d'une compétition acharnée dans le domaine de l'équipement militaire : c'est la course aux armements. La maîtrise de la bombe A par les Soviétiques en 1949 avait entraîné une vague d'angoisse dans la population américaine et fortement contribué au succès du maccarthysme. Le 1er novembre 1952, les Etats-Unis démontrent une nouvelle fois leur avance en testant la bombe H . La bombe à hydrogène, ou bombe à fusion nucléaire, est beaucoup plus puissante qu'une bombe A. Tandis que la puissance de cette dernière est estimée en kilotonnes de TNT, celle de la bombe H se compte en mégatonnes.
Avec ce nouvel équipement, les Etats-Unis pensent retrouver leur force de dissuasion. Cependant, il faut moins d'un an à l'URSS pour disposer de la même arme. Les pays alliés des Etats-Unis participent à cette course : ainsi, la Grande-Bretagne s'équipe en 1952 d'une bombe A (en 1957 pour la bombe H), la France en 1960. Côté communiste, la Chine n'obtient la bombe qu'en 1964. La bombe H la plus puissante de l'histoire est testée par les Soviétiques en 1961. Développant entre 50 et 57 mégatonnes, elle représente environ 4 000 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Parallèlement à ces avancées militaires, les blocs vont aussi s'affronter dans le domaine de la conquête spatiale , un autre terrain de compétition où l'URSS prend les premières initiatives.
Berlin et le mur de la honte
Si le cas de l'Allemagne semble avoir été réglé par la partition du pays en 1949-50, le statut de Berlin est encore problématique. Le pays avait en effet été coupé en deux après la Seconde Guerre mondiale, avec une Allemagne communiste tournée vers l'URSS et une Allemagne occidentale occupée par les Britanniques, les Américains et la France. La ville de Berlin a quant à elle été divisée en quatre morceaux, formant une enclave occidentale à l'Est. Construit en 1961 afin de séparer l'Allemagne de l'Est (RDA) et l'Allemagne de l'Ouest (RFA), le mur de Berlin devait limiter l'exode croissant des Allemands de l'est vers l'ouest. Le "mur de la honte" reste en place plus de 28 ans, jusqu'à ce célèbre jour du 9 novembre 1989.
Crise des missiles de Cuba
En 1962, le conflit change subitement de visage avec la crise des missiles de Cuba. Après la révolution cubaine et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro , les rapports se tendent avec les Etats-Unis. Le président Kennedy prend la décision de renverser le nouveau pouvoir en place, mais échoue. Les cubains en profitent pour s'allier à l'URSS. Alors que les Américains avaient installé des rampes de lancement de missiles en Europe, les Soviétiques font de même sur l'île cubaine.
De 1962 à 1991, la fin de la Guerre froide
Avec la crise des fusées, la coexistence pacifique a montré ses limites. N'ayant pas empêché la course aux armements et n'excluant pas les provocations, elle n'a pas écarté le risque d'une Troisième Guerre mondiale. A l'image de la guerre de Corée , le climat de tension paroxystique incite à changer de politique dans les camps, revirement permis encore une fois par les renouvellements à la tête de chaque Etat. En effet, Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963, tandis que Khrouchtchev est relevé de ses fonctions le 15 octobre 1964. Une nouvelle ère peut alors s'ouvrir : l'ère de la Détente .
La détente de 1962 à 1974
A la suite du conflit cubain, les deux grands "ennemis" se rapprochent. Des traités sont signés en matière d'armement et le fameux téléphone rouge est installé entre le Kremlin et la Maison-Blanche en 1963. Pourtant, les efforts des deux pays sont stoppés par l' assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. Le président américain est mortellement touché lors d'un défilé. Un certain Lee Harvey Oswald est arrêté quelques heures plus tard. L'année suivante, en octobre 1964, Nikita Khrouchtchev est écarté du pouvoir par les autres dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique. Un nouveau couple va ainsi entrer aux commandes : Léonid Brejnev pour l'URSS et Lyndon Johnson pour les USA.
Toutes deux favorables à la détente, les deux puissances vont chacune se focaliser sur des terrains différents facilitant le dialogue et les échanges. Les Etats-Unis vont ainsi s'engager massivement dans la guerre du Viêt Nam à partir de 1965. Le conflit dure déjà depuis les années 1950 au sein du pays scindé par les accords de Genève. Kennedy avait tenté d'intervenir, mais lorsque des navires américains sont pris pour cible dans le golfe du Tonkin, les USA ne peuvent pas ignorer l'attaque. Le pays est bombardé et des troupes sont envoyées. Richard Nixon arrive au pouvoir en 1969 et poursuit la guerre. Le conflit s'enlise jusqu'aux accords de Paris en 1973. Les Américains se retirent et le Nord Viêt Nam communiste réunifie le pays par la force en 1975.
Les Soviétiques se concentrent quant à eux sur la puissance de leur pays. La course à l'armement est relancée au prix de gros efforts économiques. La propagation du communisme devient indispensable. Lorsqu'Alexander Dubček arrive au pouvoir en 1968 en Tchécoslovaquie, le nouveau leader accumule les réformes pour plus de démocratie et de liberté. C'est le Printemps de Prague . L'URSS réagit rapidement et, quelques mois plus tard, le pays est envahi par les troupes soviétiques du Pacte de Varsovie. Dubček est évincé, les réformes sont abandonnées et le pays perd une partie de sa souveraineté.
La détente a aussi lieu en Europe avec l' Ostpolitik de l'Allemagne de l'Ouest (RFA) menée par le chancelier Willy Brandt , qui vise à faciliter les relations avec le bloc de l'est. La France de Charles de Gaulle prend quant à elle ses distances face aux Etats-Unis et se retire de l'OTAN, tout en restant membre de l'Alliance atlantique. En 1975, trente-trois états européens en plus des USA et du Canada signent les accords d'Helsinki . Ce pacte entérine un certain nombre de concessions acceptées par les deux blocs sur la coopération économique, la liberté, la sécurité et les droits de l'homme.
Dans le reste du monde, la situation n'est pas aussi détendue. La Chine rompt avec l'URSS en raison de son idéologie communiste divergente et tente d'obtenir l’allégeance d'autres pays communistes. A la fin de la guerre du Viêt Nam, Chine et Etats-Unis se rencontrent. L'ONU admet la Chine au Conseil de sécurité. En Asie, les conflits se succèdent. Les Khmers rouges contrôlent notamment le Cambodge. Le conflit israélo-arabe est nourri par la Guerre froide. La décolonisation se poursuit en Afrique, tandis que l'Amérique latine lutte contre le communisme.
La guerre fraîche de 1975 à 1985
Le scandale du Watergate et le premier choc pétrolier de 1973 affaiblissent les USA et Richard Nixon est contraint de démissionner en 1974. Les Américains s'isolent et les Soviétiques en profitent pour intervenir plus largement dans le monde. C'est la "guerre fraîche". Malgré les accords sur l'armement signés entre Jimmy Carter et Léonid Brejnev en 1979, la guerre d'Afghanistan (1979 – 1989) fait monter le conflit d'un cran. Les Soviétiques interviennent en effet en décembre 1979 sur le territoire afghan, afin de soutenir la faction afghane communiste du pays. De plus, en 1977, l'URSS a installé des missiles à ses frontières pouvant notamment atteindre l'Europe. C'est la crise des euromissiles . En réponse, les Etats-Unis lancent la doctrine Carter, qui annonce le recours à la force en cas d'ingérence dans le golfe Persique, et le boycott des Jeux olympiques de 1980.
Elu en 1981, Ronald Reagan devient le nouveau président des Etats-Unis. Conservateur, il durcit les relations avec l'URSS, notamment lorsque les Soviétiques abattent un avion reliant New York à Séoul en 1983. La même année, il rend publique l' Initiative de défense stratégique (IDS), que les médias surnomment "guerre des étoiles". Il s'agit d'un bouclier de protection capable d'arrêter les missiles au-dessus du pays. De son côté, l'OTAN tente de résoudre la crise des euromissiles en installant à son tour des armes pouvant atteindre l'URSS, et en entamant des négociations avec les Soviétiques. Un accord est finalement trouvé en 1988. Une nouvelle détente est entamée.
La nouvelle détente de 1985 à 1991
L'année 1985 est marquée par l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir à l'est. La plupart des anciens dirigeants du parti communiste sont décédés après la mort de Léonid Brejnev en 1982, emportant avec eux la ligne dure du parti. Appartenant à une nouvelle génération plus encline à la détente, Gorbatchev entame la restructuration et l'ouverture économique de l'URSS ( perestroïka ) et élargit le cadre des libertés de ses habitants ( glasnost ). Mais le territoire ne semble pas prêt à de tels changements et sombre dans une crise économique, puis politique, jusqu'à son effondrement en 1991.
Les deux mandats de Reagan (1981 – 1989) à la présidence des Etats-Unis ont entraîné la reprise des dépenses militaires à grande échelle. Les Américains ont multiplié les avancées technologiques et les Soviétiques commencent à avoir du mal à suivre. La course à l'armement est considérée comme un autre des facteurs à l'origine de l'effondrement de l'URSS. Dès son arrivée au pouvoir, Gorbatchev, conscient des problèmes économiques de son pays, multiplie les rencontres internationales et en appelle donc au désarmement mondial. Le dirigeant est récompensé de ses efforts et des différents traités signés par le prix Nobel de la paix en 1990.
En 1988, Gorbatchev fait un discours à l'ONU, où il condamne le recours à la force dans la politique étrangère et valide la liberté de choix des populations. De nouvelles bases sont posées, l'armée soviétique n'interviendra plus pour protéger les régimes communistes des différents pays d'Europe de l'est. Gorbatchev se retire de la guerre d'Afghanistan. L'émancipation des peuples sous tutelle soviétique est lancée et prend une tournure imprévue lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Cet événement provoque d'ailleurs la levée du rideau de fer, la chute des régimes communistes à l'est et la réunification de l'Allemagne.
La chute de l'URSS et le dénouement de la guerre froide
En 1991, l'élection de Boris Eltsine en tant que président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et le putsch de Moscou par des communistes "extrémistes" affaiblissent de nouveau le pouvoir soviétique en place. Les partisans de la République d'Eltsine et les présidents élus en Biélorussie et en Ukraine signent l'accord de Minsk , afin que les Etats acquièrent leur indépendance. La CEI (Communauté des États indépendants) est créée, l'URSS a disparu et Mikhaïl Gorbatchev démissionne. La guerre froide prend fin avec la disparition de l'un des principaux protagonistes, et laisse la place à une unique super-puissance : les Etats-Unis, pour un nouvel ordre mondial.
LA GUERRE FROIDE : DATES CLÉS
- Les causes de la guerre froide
- Qui a gagné la guerre froide
- Les conséquences de la guerre froide
- Les causes de la guerre d'algérie 1954 > Guide
- Conquête spatiale guerre froide > Guide
- Les causes et les conséquences de la guerre civile espagnole > Guide
- Les causes de la guerre du vietnam > Guide
- Les causes de la guerre de corée > Guide
- Révolution cubaine : par Fidel Castro et Che Guevara en 1959
- Concile Vatican II : changements, résumé du concile de 1962
- Génocide au Rwanda : massacre des Tutsi par les Hutu en 1994
- Conférence de Bandung : résumé de la réunion du tiers monde
- Guerre des Six Jours : la victoire d'Israël en 6 jours
- Doctrine Jdanov : la naissance d'un monde bipolaire, résumé
- Massacre de Mỹ Lai : crime de guerre américain au Viêt Nam
- Révolution mexicaine : causes, date, résumé de la révolte
- Révolution russe : la prise de pouvoir communiste
- Massacre de Sabra et Chatila : résumé et nombre de morts
- Guerre du Kippour : résumé de la guerre israélo-arabe de 1973
- Massacre de la Saint-Valentin : piège d'Al Capone à la mafia irlandaise
- Massacre d'Oran : fin de la Guerre d'Algérie le 5 juillet 1962
- Guerre de Bosnie : Sarajevo, Srebrenica, chronologie, résumé
- Droit de grève en France : interdiction et reconnaissance
- Bloody Sunday : le dimanche sanglant de 1972 en Irlande
- Guerre des Malouines : résumé du conflit de 1982
- Affaire du sang contaminé : résumé et chiffres du scandale
- Doctrine Truman : la politique d'endiguement des Etats-Unis
- Guerre du Rif : les prémices de la décolonisation, 1921-1926
- Les lois de Nuremberg : 1935, le texte antisémite des nazis
- Nuit des longs couteaux : la purge nazie de 1934
- Première Guerre mondiale
- Seconde Guerre mondiale
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
Le traitement de votre email à des fins de publicité et de contenus personnalisés est réalisé lors de votre inscription sur ce formulaire. Toutefois, vous pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.
Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de prospection commerciale et ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité ou notre politique Cookies .
📚 Révise ton bac en podcast ici ! 🎧
La bipolarisation du monde durant la guerre froide
Le monde depuis 1945
hge3_1709_13_00C
Polynésie française • Septembre 2017
maîtriser les différents langages • 20 points
▶ 1. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur un exemple d'affrontement entre l'Est et l'Ouest étudié en classe, présentez la bipolarisation du monde durant la guerre froide. (15 points)
▶ 2. Placez et datez sur la frise chronologique, les événements suivants : la création de l'ONU, la guerre froide (début et fin), la chute du mur de Berlin et le traité de Rome. (5 points)

Les clés du sujet
▶ 1. En introduction, commence par rappeler quelles puissances s'opposent durant la guerre froide et quelles sont les dates de ce conflit.
Dans un premier paragraphe, définis les deux camps et les raisons de leur rivalité.
Dans un second paragraphe, présente l'exemple étudié en classe (localisation, dates, principaux acteurs) en montrant comment les deux camps sont impliqués et comment se traduit leur affrontement.
En conclusion, tu peux proposer une définition de la guerre froide qui soit adaptée à l'exemple que tu as décrit.
▶ 1. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs américain et soviétique se retrouvent face à face. Ils n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes buts. Une guerre froide les oppose de 1947 à 1991 . Comment le monde s'organise-t-il pendant cette période ?
info +
Les accords de Bretton Woods (1944) rassemblent les pays de l'Ouest dans une alliance économique et monétaire.
En 1947, les États-Unis et l'URSS rompent toutes relations et se disputent la domination du monde selon leurs convictions idéologiques . Les Américains défendent les valeurs de la démocratie libérale et du capitalisme. Ils forment un bloc de pays dans le cadre d' alliances politiques et militaires (OTAN, OTASE). Ils aident leurs alliés à se reconstruire (plan Marshall) et à se développer (CEE). L'URSS, qui défend l'idéologie communiste, réplique en unissant ses alliés d'Europe de l'Est (Pacte de Varsovie). Les deux blocs ainsi constitués rivalisent pour étendre leur influence tout en évitant une guerre frontale.
L'exemple de Cuba sert de modèle. Change les noms et informations si tu as étudié un autre exemple. Pour l'essentiel, l'organisation du développement reste la même.
De nombreuses crises les opposent. Celle dite des fusées à Cuba est la plus grave de la période (1962). À la suite d'une révolution, les Cubains demandent l'aide de l'URSS. Celle-ci prépare le déploiement sur l'île de missiles capables d'atteindre le sol des États-Unis. Le président américain John Kennedy riposte par un blocus de Cuba et menace l'URSS d'une guerre nucléaire. Après une semaine de tensions, les Russes renoncent. La guerre est évitée.
Ainsi, entre 1947 et 1991, le monde s'organise selon une logique bipolaire. La guerre froide est un affrontement entre deux blocs idéologiques au cours duquel les principaux adversaires s'affrontent par personnes interposées, jamais directement.

Pour lire la suite
Et j'accède à l'ensemble des contenus du site
Et je profite de 2 contenus gratuits

La culture, un enjeu central de la guerre froide (1947-1991)
- Prépa Littéraire
- 03 juin 2022
- Maxime Dhuin

33 000 abonnés
40 000 abonnés
38 000 abonnés
7 600 abonnés
2 000 abonnés

Major Prépa > Académique > Histoire > La culture, un enjeu central de la guerre froide (1947-1991)

La guerre froide (1947-1991) est une période historique qu’il te faut absolument maîtriser pour les concours. En B/L, elle tombe fréquemment en khôlle ou en dissertation. Pour les A/L, elle est au cœur du programme d’oral si tu passes l’ENS de la rue d’Ulm en 2023. Nous allons aujourd’hui nous pencher sur la culture comme enjeu central de la guerre froide.
La guerre froide : un conflit à dimension idéologique
Pour comprendre l’importance de la culture dans l’affrontement Est-Ouest, il faut avoir en tête que la guerre froide est marquée par la concurrence de deux idéologies . D’un côté, le libéralisme capitaliste américain, et de l’autre, le communisme soviétique.
D’après l’historien Stanislas Jeannesson ( La Guerre froide , 2002) , cette opposition joue un rôle « à la fois moteur et justificateur ». Elle va rythmer le conflit sur toute sa longueur. Soviétiques et Américains défendraient des systèmes de valeurs incompatibles, dont l’un finirait nécessairement par triompher.
Dès lors, on n’est pas seulement face à un conflit économique et territorial. La dimension culturelle est ici clé, puisqu’il faut convaincre l’autre du bien-fondé de ses positions . La guerre froide est donc aussi une guerre culturelle et d’information . Chacun veut incarner le « monde libre » et dénonce agressivement le modèle adverse. En résulte une opposition Est/Ouest qui, si elle n’est pas complètement fausse, reste plutôt caricaturale. Les deux systèmes se trouvent en effet présentés de façon souvent simpliste.
Il est aisé d’illustrer cette volonté de décrédibiliser l’adversaire et son idéologie. Par exemple, Soviétiques et Américains se pointent mutuellement du doigt comme les héritiers du nazisme. En URSS, on dénonce le capitalisme comme source de conflits : l’impérialisme américain d’après-guerre aurait pris le relais de l’expansionnisme nazi. Aux États-Unis, les universitaires spécialisés en science politique développent le concept de totalitarisme, permettant un rapprochement entre les modèles stalinien et hitlérien.
Une culture de guerre froide ?
Nous avons vu qu’un combat idéologique est à l’œuvre de 1947 à 1991. Il implique toutes les populations et les sociétés, et mobilise largement la culture. Celle-ci permet, aux Soviétiques comme aux Américains, de véhiculer leur système de représentations du monde.
Le soft power , défini par le géopolitologue américain Joseph Nye comme « l’habileté à séduire et à attirer », va jouer un rôle majeur. L’URSS porte le flambeau de l’antifascisme et les États-Unis cherchent à promouvoir l’ American Dream .
Cette opposition passe évidemment par la propagande. Jeannesson rappelle cependant que celle-ci est peu efficace. D’après lui, la « culture de guerre froide », c’est avant tout des comportements et des représentations du monde. Elle est « d’autant plus prégnante qu’elle est appropriée et intériorisée ». Les discours patriotiques et les postures idéologiques investissent le quotidien. Chacun doit être « sincèrement persuadé de la supériorité de son système sur celui de l’autre et du caractère inéluctable de la victoire finale ». Un bon exemple de la dimension quotidienne de cette culture de guerre froide est la diffusion de marques comme Coca-Cola ou de produits comme le blue jean ou le chewing-gum en Europe à la suite du Plan Marshall. L’ intelligentsia européenne procommuniste dénonce d’ailleurs une « Coca-colonisation ».
Il faut cependant bien nuancer le caractère politique de certaines productions ou de certains évènements. Par exemple, en 1972, l’Américain Bobby Fischer bat le Russe Boris Spassky, mettant fin à l’hégémonie soviétique sur les compétitions internationales d’échecs. Le « match du siècle » revêt une dimension politique. Il est largement évoqué dans les médias et Henry Kissinger, conseiller diplomatique du gouvernement américain, appelle Fischer pour le convaincre de participer à la compétition.
On peut néanmoins remettre en cause l’intention politique des deux champions. Ils déclarent s’estimer mutuellement et refusent de jouer le rôle qu’on souhaite les voir endosser, puisqu’ils privilégient les enjeux sportifs du match. La dimension politique réside ici davantage dans la réappropriation du « match du siècle » par les gouvernements étasunien et soviétique.
Quelles différences entre l’Ouest et l’Est pour ce qui est de la culture de guerre froide ?
Soviétiques comme Américains poursuivent les deux mêmes objectifs :
- diffuser ses idées dans le camp d’en face ;
- assurer une certaine cohésion idéologique interne : il faut mobiliser sa propre population.
L’entreprise peut sembler plus aisée pour l’URSS que pour les États-Unis. À l’Est, la liberté d’expression n’est pas garantie. Les journaux, les radios, les syndicats, les arts et la culture sont pour l’essentiel officiels. Les États communistes semblent pouvoir influencer plus facilement leur population et éviter la contagion des idées occidentales.
À l’inverse, il existe une liberté d’expression à l’Ouest . Aux États-Unis, il s’agit même du premier amendement de la Constitution . Les yankees doivent composer avec ce principe démocratique fondamental s’ils veulent assurer une cohésion idéologique au sein de leur camp. En découlent des situations paradoxales et tendues, par exemple sous l’hystérie anticommuniste maccarthyste entre 1947 et 1957.
Au sein du bloc de l’Est, l’essentiel des produits culturels et des médias occidentaux se diffuse de façon très contrôlée et informelle. Il existe de nombreuses radios clandestines, comme « Voice of America » ou « Free Europe ». Des produits culturels circulent via le marché noir. L’empire de l’Américain Elvis Presley s’étend jusqu’à Moscou grâce à des copies pirates de ses enregistrements qui s’achètent 100 $ au marché noir.
Dans le bloc de l’Ouest, la diffusion de l’idéologie socialiste peut sembler plus facile. Les Soviétiques peuvent s’appuyer sur les partis communistes locaux, des organes de presse ou des maisons d’édition . En France, on peut citer le Parti communiste français (PCF) ou le quotidien L’Humanité .
Comme le rappelle Jeannesson, la diffusion des idées soviétiques n’est pas facile pour autant. Si les partis communistes sont puissants en France ou en Italie, leurs effectifs réduisent comme peau de chagrin aux États-Unis, notamment grâce au maccarthysme. En RFA, le PC est carrément interdit par la Cour constitutionnelle entre 1956 et 1968.
Quelles formes prend la culture de guerre froide ?
Les milieux littéraires.
À l’Ouest, de nombreux intellectuels et hommes de lettres s’engagent pour le communisme ou du moins contre le capitalisme et l’américanisme. On peut prendre l’exemple du Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR), un parti politique éphémère des années 1940. Il compte dans ses rangs des figures comme Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty.
La diffusion de livres venus de l’Est et dénonçant les vices et les crimes du régime soviétique joue un rôle clé dans l’idéologie anticommuniste occidentale. On peut citer L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne . Paru en 1973, il participe selon Stanislas Jeannesson d’un éloignement progressif de l’ intelligentsia occidentale communiste avec Moscou.
Un autre évènement illustre bien le rôle politique de certaines productions littéraires pendant la guerre froide. En 1958, l’Académie suédoise accorde le prix Nobel de littérature à Boris Pasternak . Cette décision est motivée par la publication à l’Ouest du Docteur Jivago l’année précédente. En raison notamment de ses positions indépendantes par rapport à la Révolution russe, le manuscrit avait été interdit en URSS. Il aurait prétendument été publié grâce à l’aide de la CIA.
Les autorités soviétiques entament une violente campagne anti-Pasternak, dénoncé comme un « agent de l’Occident capitaliste ». L’auteur se voit menacé de ne pas pouvoir rentrer en URSS s’il va recevoir sa récompense à Stockholm. Pasternak n’ira donc jamais chercher son prix. Docteur Jivago ne paraît qu’en 1985 sous la perestroïka, période d’ouverture de l’URSS au moment du déclin du Bloc de l’Est.
En tant que média de masse, le cinéma joue un rôle prépondérant. Il permet la mise en scène des différents modèles et donc d’en promouvoir certains ou d’en déprécier d’autres. Jeannesson insiste à ce sujet : il existe un grand décalage entre l’Est et l’Ouest.
Dans le bloc atlantiste, la guerre froide est omniprésente. On peut prendre l’exemple des nombreux James Bond ( Bons baisers de Russie , en 1963), mettant en scène les communistes comme les méchants du film, ou encore Rocky IV de Sylvester Stallone (1985). Le héros s’oppose à Ivan Drago, un combattant venu d’URSS et incarnant la froideur et l’inhumanité de l’URSS. Aux États-Unis, on produit non seulement des films dénonçant l’Est, mais on lutte aussi contre les communistes présents dans l’industrie du cinéma. Sous le maccarthysme, une liste noire à Hollywood circule. Des artistes soupçonnés de sympathie avec le parti communiste américain se voient refuser tout emploi.
À l’Est, on parle moins de la guerre froide, mais le cinéma n’en est pas moins utilisé à des fins de propagande. En 1946 est entamée la période du « jdanovisme » du nom d’Andreï Jdanov, proche de Staline qui joue un rôle majeur dans la politique culturelle soviétique. La production cinématographique est largement contrôlée par le régime qui favorise des films valorisant le régime.
Peu de films sont produits et on parle parfois de « l’époque du manque de films » ou « Epokha Malokartinia ». On a parfois parlé d’un « dégel du cinéma soviétique » à la mort de Staline en 1953 . À en croire l’historienne Natacha Laurent, la reprise n’a pas l’envergure qu’on a voulu lui donner par la suite. En 1958, la Palme d’or remportée à Cannes par Mikhaïl Kalatozov pour Quand passent les cigognes illustre cependant bien la période de la coexistence pacifique.
La radio, une arme médiatique
Lénine parlait de la radio comme du « journal sans papier ni frontières » . De fait, celle-ci va jouer un rôle essentiel tout particulièrement dans la diffusion informelle vers l’Est des idées capitalistes et libérales.
Dès 1946, la BBC lance un programme quotidien d’une heure en russe . Elle propose des bulletins d’information et des leçons d’anglais. En 1947, en parallèle de la Doctrine Truman, la radio « Voice of America » lance des émissions russophones et bénéficie de crédits considérables. Elle se fait le relais d’un anticommunisme particulièrement virulent sous l’ère maccarthyste. Cette stratégie suit la logique déployée par Eisenhower en 1955 : « Le jour où les peuples communistes seront aussi bien informés que ceux des nations libres, les révoltes spontanées naîtront et renverseront le communisme. »
À en croire Jean Delmas et Jean Kessler (1999), il est difficile d’évaluer les effets de cette propagande occidentale sur les populations à l’Est. Néanmoins, on sait que l’URSS a cherché à brouiller les ondes et a même fait de l’écoute d’une radio étrangère un « crime idéologique » à partir de 1948. On peut en déduire que l’audience était suffisamment importante pour que le régime soviétique se sente menacé.
L’URSS cherche aussi à lancer ses propres radios à l’international. On peut citer Radio Moscou , tournée vers l’international dès 1929. Des services en langue anglaise et même en français sont développés pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, cette radio n’a qu’un impact très réduit. Elle encaisse par ailleurs mal les soubresauts de la déstalinisation. Il ressort que les États-Unis sont les grands vainqueurs de la guerre médiatique.
La musique et le spectacle vivant
Les Soviétiques sont particulièrement présents dans le domaine du spectacle vivant. Les Tournées des Chœurs de l’Armée Rouge attirent des milliers d’Occidentaux. Fondés en 1928, ces groupes censés appuyer l’armée deviennent la vitrine du soviétisme triomphant . Ils voyagent dans l’Ouest en apportant le drapeau, l’étoile rouge, la faucille et le marteau. Les symboles de la Révolution se diffusent. On peut également citer les ballets du Bolchoï et le Cirque de Moscou qui mettent en avant l’image d’une Russie pacifique.
Pour les Américains, la musique en tant qu’art populaire joue un rôle clé dans le soft power . Le jazz et le rock envahissent l’Europe entière et menacent de subvertir la jeunesse socialiste. Les radios qu’on a évoquées plus haut diffusent des chansons en anglais. Cela permet par exemple à la Beatlesmania de gagner l’Est. Ces exportations déplaisent en URSS, où des « brigades de la musique » traquent les rockers locaux. Les membres d’AC/DC sont condamnés pour « néofascisme » et Tina Turner pour pornographie. Le phénomène ne s’en trouve pas pour autant endigué.
On aurait aussi pu parler du sport qui est au cœur de la guerre froide. N’hésite pas à consulter l’article consacré au sujet , ainsi que sa deuxième partie juste ici !
En conclusion
La culture est au cœur de la guerre froide. Elle véhicule les différentes idéologies qui se font face. Par ailleurs, les échanges culturels Est/Ouest plus ou moins fluides illustrent bien les relations instables entre les deux blocs.
Si les différentes séquences de la guerre froide de « la Détente » à la « Guerre fraîche » en passant par la perestroïka ne te sont pas familières, n’hésite pas à consulter nos autres articles qui les décryptent plus précisément !
À lire également
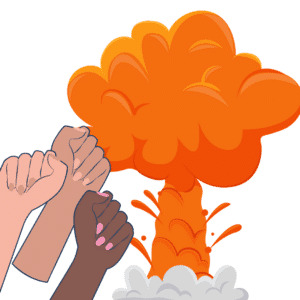
Droits de l’homme et guerre froide
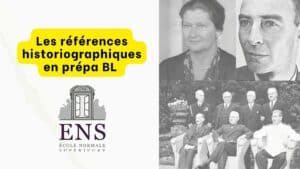
Les références historiographiques essentielles en prépa B/L
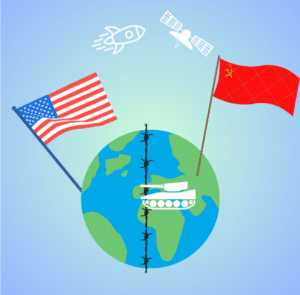
Fiche de lecture « La Loi des géants : 1941-1964 » (2/2)
Fiche de lecture “la loi des géants : 1941-1964” (1/2).

- Newsletters
- Classements
- Business schools
- Écoles d'ingénieurs
- Grandes Écoles
- Business Cool
- Capitaine Study
Abonne-toi à la newsletter Major Prépa !
Le condensé des meilleures ressources de Major Prépa, toutes les semaines. 💌

La France à l'heure de la Guerre froide
Testez vos connaissances sur ce quiz.

A Une puissance fragilisée
1 la france sous le leadership des états-unis, 2 une reconstruction à lʼéchelle européenne sʼimpose, 3 l'empire colonial en question, b le temps des décolonisations, 1 une décolonisation devenue inéluctable, 2 lʼémancipation de colonies africaines.

Marcelle Devaud (1908-2008)
Vocabulaire.
- Atlantisme : doctrine politique reposant sur l'idée d'une coopération très forte, notamment sur le plan diplomatique et militaire, entre les États-Unis et l'Europe occidentale.
- CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier mise en place en avril 1951 et composée de six États membres : la France, l'Italie, l'Allemagne (RFA), la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
- CED : projet de défense européenne qui vise à insérer le réarmement de l'Allemagne dans une armée européenne. Il divise la classe politique française et est rejeté par un vote de l'Assemblée en 1954.
- Départementalisation : loi de mars 1946 qui érige les quatre « vieilles colonies » (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) en départements.

Habib Bourguiba (1903-2000)
- Communauté française : association politique entre la France et ses colonies, qui obtiennent une autonomie plus importante et peuvent sʼadministrer elles-mêmes.
- Loi-cadre : loi au contenu très général définissant les orientations d'une politique.
Le document du cours
Doc. 1 carte interactive la décolonisation de lʼafrique.
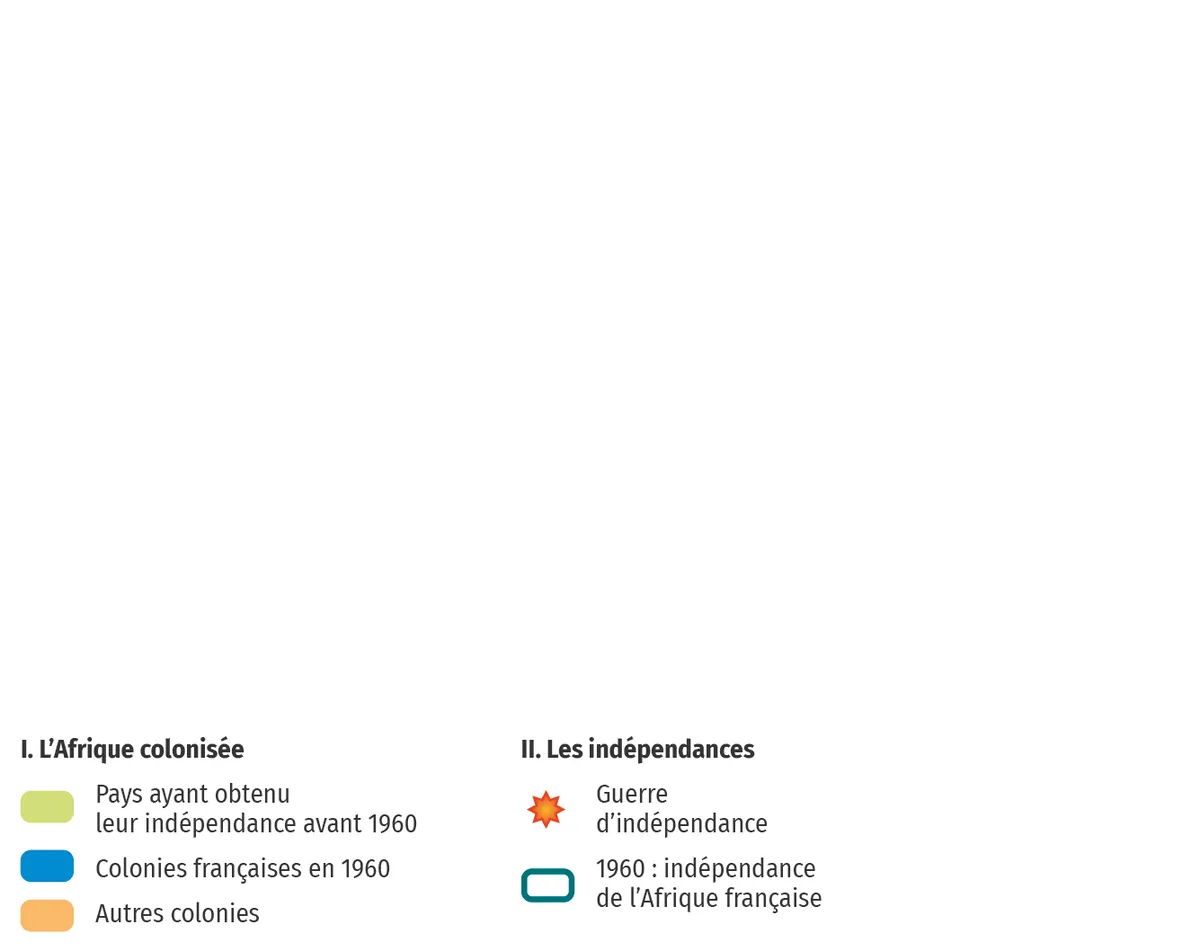
Histoire et fiction
Une erreur sur la page une idée à proposer .
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !
Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais
Chaque mois GEO directement chez vous !
8.90 € par mois au lieu de 11.68 €
Avec GEO, partez chaque mois à la découverte du monde
Explorez les plus beaux pays à travers des reportages photo époustouflants et des carnets de voyages étonnants. Un magazine qui vous permet de voir le monde autrement.
Grand Calendrier GEO 2024 - Souffle d'ailleurs !
Du lac Tekapo en Nouvelle Zélande à Kyoto au Japon, du Worimi national park en Australie au site Landmannalaugar en Islande , en passant par les Asturies en Espagne, découvrez ces 12 clichés d’exceptions choisis spécialement pour le Grand Calendrier GEO 2024.

- Mes préférences de communication
- Gérer mon profil
La Guerre Froide résumée en 11 dates clés
La guerre froide s'installe à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Elle durera jusqu'à la dislocation de l'URSS en décembre 1991.
Partager sur :
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale , les Alliés réorganisent l’Europe et décident du sort de l’Allemagne vaincue, divisée en quatre zones d’occupation. Tout au long du XXème siècle, deux superpuissances s’affrontent : les États-Unis et l’URSS, c’est la démocratie américaine face au communisme soviétique. Ces deux puissances possédant l’arme nucléaire, l’affrontement peut dégénérer en troisième guerre mondiale avec des conséquences atomiques.
Les deux « blocs », qui ont chacun de puissants alliés, ne s’opposent jamais directement. Mais l’Histoire aurait pu basculer à plusieurs reprises ( guerre de Corée , crise de Cuba, etc.). Un « rideau de fer », invisible, sépare symboliquement les deux blocs. À Berlin, principal théâtre de la Guerre Froide, il est matérialisé par un « mur de la honte ».
1945 : la conférence de Yalta
Du 4 au 11 février, Churchill , Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta, en Crimée, pour décider du sort de l’Allemagne vaincue. Ils décident des modalités d’occupation de l’Allemagne, divisée en quatre zones d’occupation.
Berlin , en zone soviétique, sera aussi découpée en quatre secteurs. Si la conférence de Yalta débouche sur l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon et la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), elle est suivie, en juillet et août de la même année, par la conférence de Potsdam, où l’atmosphère est plus tendue. En effet, l’Armée rouge a mis en place des gouvernements communistes dans tous les pays libérés par les Soviétiques, ce que les Américains ne voient pas d’un très bon œil.
12 mars 1947 : la Doctrine Truman
Le président américain Harry S. Truman présente devant le Congrès sa doctrine du containment , qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l’expansion soviétique, tels que la Grèce et la Turquie. Cette doctrine, réaction d’un monde libre face à l’agression soviétique, justifie l’ingérence des États-Unis dans les affaires des pays démocratique. Truman rompt ainsi avec la politique de son prédécesseur, Franklin D. Roosevelt, et redéfinit la politique extérieure des États-Unis. L’isolationnisme laisse place à l’interventionnisme.
5 juin 1947 : le Plan Marshall
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est dans une mauvaise situation économique. Soucieux de relever l’économie européenne pour assurer les exportations des États-Unis, mais aussi pour éviter la tentation soviétique, le secrétaire d’État américain George C. Marshall propose à tous les pays d’Europe une assistance économique et financière dans un discours prononcé à Harvard le 5 juin 1947. C’est le plan Marshall . Le 16 avril 1948, les seize pays qui l’ont accepté signent à Paris la Convention qui établit l'Organisation européenne de coopération économique (OECE).
22 septembre 1947 : la doctrine Jdanov
Le 22 septembre 1947, les délégués des partis communistes de l’URSS, de Pologne, de Yougoslavie, de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d’Italie et de France se réunissent près de Varsovie. Ils créent le Kominform , un moyen pour l’URSS de contrôler étroitement les partis communistes d’Occident.
Le bras droit de Staline, Andreï Jdanov, énonce que le monde est désormais divisé en deux camps : un camp « impérialiste et anti-démocratique », dirigé par les États-Unis, et un camp « anti-impérialiste et démocratique », dirigé par l’URSS. Cette doctrine Jdanov est une réponse à la doctrine Truman et confirme une situation qui est partie pour durer : le monde est bipolaire.
1948-1949 : le blocus de Berlin
En 1947, les Anglais et les Américains fusionnent leurs zones d’occupation et mettent en place une monnaie unique. Inquiet de la reconstitution d’une Allemagne qui lui serait hostile, Staline établit un blocus pour empêcher le ravitaillement des deux millions de Berlinois qui vivent à l’Ouest le 24 juin 1948. Toutes les voies de communication sont coupées et contrôlées par les Soviétiques, sauf la voie aérienne.
Le général américain Clay en profite pour mettre en place un pont aérien et ravitailler la ville : pendant près d’un an, les Berlinois de l’Ouest reçoivent plus de deux millions de tonnes de nourriture et de charbon. Force est de constater pour Staline que son blocus est un échec. Il le lève le 12 mai 1949.
25 juin 1950 : Guerre de Corée
Les troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38ème parallèle qui sépare le nord, sous influence soviétique, et le sud, sous influence américaine. Les États-Unis engagent l’Organisation des Nations unies (ONU) dans la défense de la Corée du sud et une force internationale composée de seize pays se constitue.
Le général américain MacArthur aurait voulu utiliser l’arme nucléaire contre la Chine communiste, alliée de la Corée du nord qui multiplie les contre-offensives. En refusant d’utiliser la bombe atomique, le président Truman évite un nouveau conflit mondial. La guerre de Corée se poursuit jusqu’à la signature d’un armistice en juillet 1953.
Août 1961 : construction du mur de Berlin
Les Allemands de l’Est (RDA) envient la prospérité économique et la liberté d’expression des habitants de l’Allemagne de l’Ouest (RFA). Après l’échec de la révolte de 1953, ils sont des centaines de milliers à passer ainsi à l’Ouest. En moins de dix ans, cet exode concerne plus de deux millions d’Allemands. Pour stopper ce phénomène, massif et continu, la RDA empêche le passage à l’Ouest en construisant, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le fameux « mur de Berlin ». Sa surveillance intensive dissuade toute tentative de transgression, même si certains s’y risqueront quand même.
octobre 1962 : crise de Cuba
Depuis le renversement révolutionnaire de la dictature militaire de Batista en janvier 1959, Cuba est gouvernée par Fidel Castro. Ce dernier se rapproche de l’URSS en signant différents accords de coopération commerciale puis militaire. Avec le débarquement d’exilés anticastristes dans la baie des Cochons, les États-Unis tentent de renverser le régime de Castro en avril 1961, mais l’opération échoue.
Le 14 octobre 1962, des avions américains repèrent des cargos soviétiques chargés de missiles et de rampes de lancement de fusées qui se dirigent vers Cuba. En réaction, Kennedy ferme toutes les voies d’accès maritimes vers Cuba. Le blocus fonctionne. Le 28 octobre, les bateaux soviétiques repartent en échange de quoi les Américains s’engagent à laisser Cuba en paix et à retirer leurs propres fusées de Turquie. La guerre nucléaire a été évitée de justesse.
avril 1985 : perestroïka et démocratisation
Un vent de démocratisation souffle sur le bloc de l’Est. Le chef de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, met en place une politique de transparence ( glasnot ) et de restructuration du régime soviétique ( perestroïka ) pour réformer l’Union soviétique en conciliant socialisme et démocratie. Au printemps 1989, il fait élire un Congrès des députés du peuple, chargé d’élire le chef de l’État soviétique et se fait élire à ce poste le 22 mai 1989. Il évince les partisans de Brejnev, continue le processus de déstalinisation entamé par son prédécesseur Khrouchtchev et garantit une nouvelle liberté d’expression à son peuple.
9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin
Le 9 novembre 1989, suite à d’importantes manifestations populaires à l’Est, le « mur de la Honte » est annoncé « perméable ». Les premières destructions physiques du Mur commencent dans la foulée. Entre rires et larmes, des scènes de liesse entre inconnus de l’Est et de l’Ouest qui se tombent dans les bras, sont diffusées à la télévision. Le 3 octobre 1990, c’est officiel, les deux Allemagne ne font plus qu’une. Le Mur de Berlin, ouvert le soir du 9 novembre 1989, est complètement démoli en novembre 1991.
26 décembre 1991 : dissolution de l’URSS
« Dissolution », « dislocation », « éclatement », « effondrement », quel que soit le terme utilisé, le 26 décembre 1991 marque la fin de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) après 69 d’existence (elle fut fondée le 20 décembre 1922). Mikhaïl Gorbatchev, huitième et dernier dirigeant soviétique, avait démissionné la veille et transmis ses pouvoirs au Président de la fédération de Russie, Boris Eltsine.
- L'histoire des Seychelles en 11 dates clés
- Guerre du Vietnam : les dates clés
- La guerre du Kippour en 4 dates clés
THÈMES ASSOCIÉS À L’ARTICLE
Chaque semaine, les dernières infos sur l'Histoire
À DÉCOUVRIR SUR LE MÊME THÈME
La guerre des balkans en 6 dates clés, mauritanie : 11 dates-clés sur l'empire des sables très disputé, la crise de 1929 résumée en 5 dates, un chien robot inspecte de dangereuses installations historiques datant de la guerre froide, quand samantha smith, 11 ans, devenait icône de la paix en pleine guerre froide, les dates clés de la libération de la france, la syrie en 70 dates clés, des royaumes oubliés à la guerre civile, le kremlin, des tsars aux autocrates : dates clés, la corée en 8 dates-clés, la régence en cinq dates clés, indépendance du gabon : les dates clés, le japon en 19 dates clés, la renaissance en 10 dates clés, la jordanie en 15 dates clés, le pays de galles en 10 dates clés, indépendance madagascar : les 10 dates clés, les routes de la soie en 14 dates clés, la création d’israël en 10 dates clés.
Getty Images
- Bibliography
- More Referencing guides Blog Automated transliteration Relevant bibliographies by topics
- Automated transliteration
- Relevant bibliographies by topics
- Referencing guides
La guerre froide
Citations de la guerre froide.
Ces pages contiennent des recueils de citations de la guerre froide faites par des dirigeants politiques, des personnalités et des historiens de la guerre froide (1945-1991). Ces citations ont été recherchées et compilées par les auteurs d’Alpha History. Nous nous félicitons des contributions et des suggestions pour ces pages. Si vous souhaitez soumettre un devis, s'il vous plaît contacter Alpha Histoire .
Les origines de la guerre froide
Leaders communistes et idées
Allemagne, Berlin et le mur de Berlin
McCarthyism et les 1950
Kennedy, Cuba et les 1960
Détente et les 1970
Reagan et les 1980
La fin de la guerre froide
Évaluer la guerre froide
- Go to content /
- Corporate navigation /
- Main navigation /
- Search form
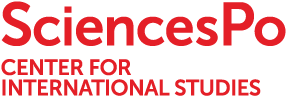
Cet obscur objet du déni : le nazisme et l'Occident
Une séance de séminaire organisée dans le cadre du groupe de recherche: Sciences Sociales et Psychanalyse.
Responsables scientifiques : François Bafoil , Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki , Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).

- Mission statement
- Fields of Research
- Map of research
- PhD Students & candidates
- Contract Researchers
- Research & Expert Associates
- Research Associates
- Visiting Scholars
- Director’s Office
- Observatories & chair
- PhD Dissertations Defended
- Research Groups
- Dossiers du CERI
- Les Etudes du CERI
- Past Series
- Publications and beyond
Menu corporate

- Admissions & financial aid
- Student Account
- Student services & life
- Virtual tours
- Alphabetical directory
- Thematic directory
- Research Units
- Faculty Account
- Faculty life & resources
- Recruitments & careers
- Recruitment (jobs & internships)
- Employee training
- Support Sciences Po
- Digital campus
- Digital Uses














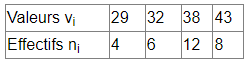
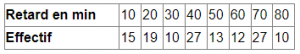
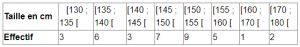























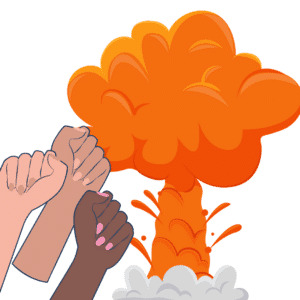
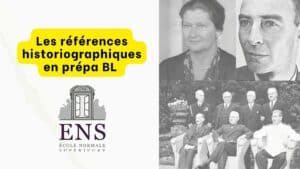
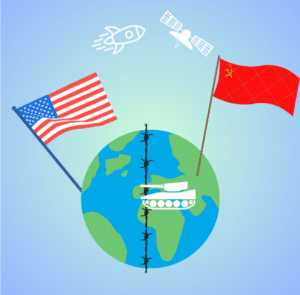





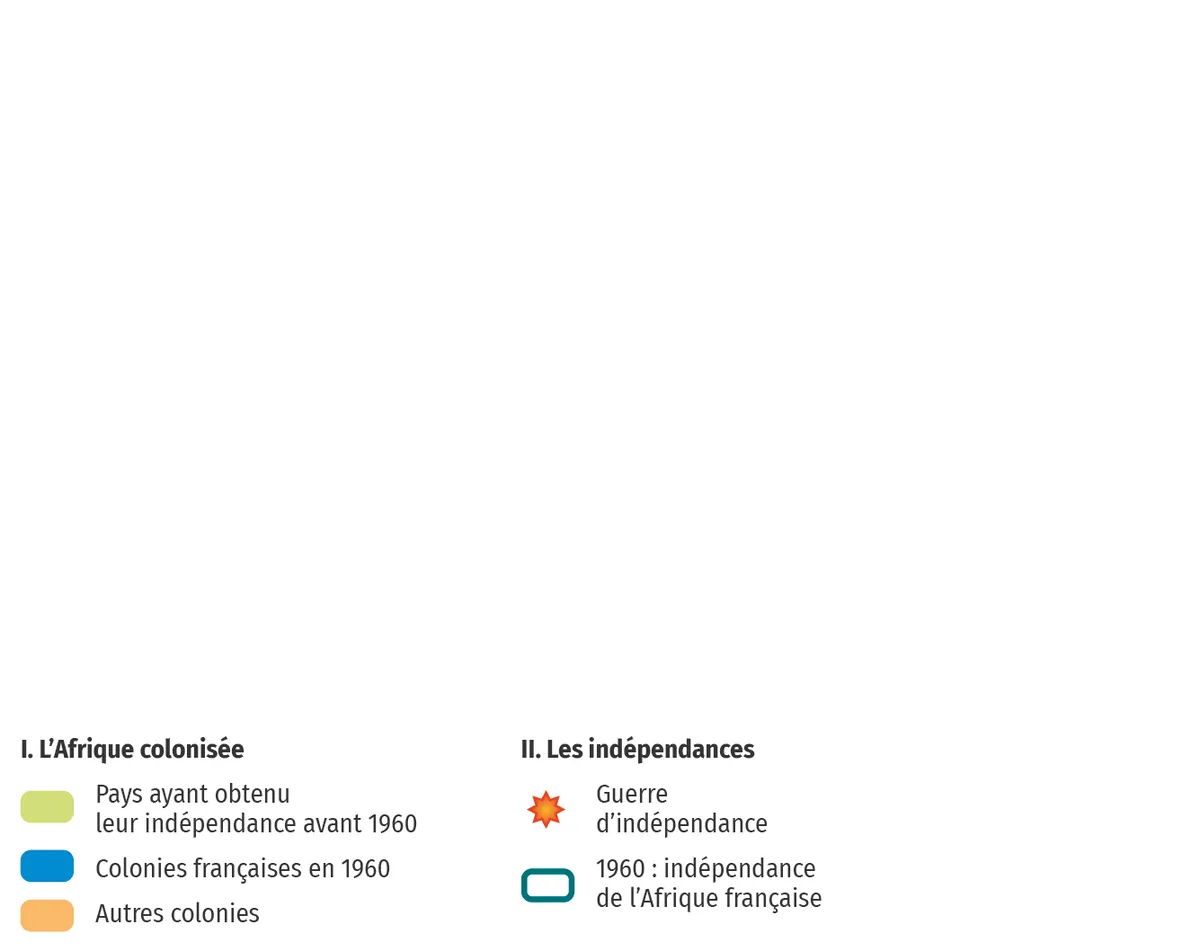
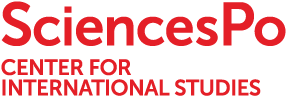



IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Vous trouverez ici quelques thèmes de dissertation au sujet de la Guerre froide : affrontement de la baie des Cochons, Guerre du Vietnam, printemps de Prague...
La guerre de Corée vient sanctionner la guerre froide que se livrent Américains et Soviétiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les Soviétiques ont occupé le nord de la Corée jusqu'au niveau du 38e parallèle ce qui marque la séparation avec la Corée du Sud, où se sont installés les Américains.
Entre 1947 et 1991, la Guerre froide a mis aux prises deux pays que tout opposait dans le cadre d'un conflit d'une double nature : conflit idéologique, d'abord, opposant deux modèles de société ; conflit territorial, ensuite, opposant deux superpuissances militaires. Ouverture.
L'entrée dans la Guerre Froide est consommée l'année suivante en juin 1948, à l'occasion de la première crise de Berlin. Le projet d'introduction dans les trois zones d'occupation occidentales d'une monnaie commune, le Deutsche Mark, entraîne le blocus de Berlin-Ouest par les Soviétiques.
Ce dossier thématique porte sur l'histoire de la guerre froide, conflit stratégique et idéologique ponctué de crises plus ou moins violentes qui opposent, de 1945 à 1989, le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS.
Lire et étudier les copies d'autres élèves permet de se familiariser avec la méthode de la dissertation en HGGMC. Disserter en géopolitique, ce n'est pas seulement réaliser mécaniquement la logique intro-plan-trois parties-conclusion.
La guerre froide est le conflit idéologique du XXe siècle. Elle débute en 1947 et s'achève avec la chute du mur de Berlin en 1989, puis l'effondrement du bloc de l'E.
Introduction. Rappel de la définition de la Guerre froide et de la montée des périls depuis 1945. I - Le dégel (1953-1975) 1- La coexistence pacifique. Ou la théorie du "bon...
Plan de dissertation. A. Le 1er conflit militaire de la guerre froide, mais un conflit limité. a) Un conflit « limité » du fait même de la guerre froide… b) …mais une guerre froide qui est confrontée à ses propres limites.
Le monde bipolaire qui émerge suite à la Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle forme de conflit, la guerre froide. Chacun des deux Grands (États-Unis et URSS) possède l'arme nucléaire et de nombreux alliés, ce qui garantit qu'une guerre ouverte serait destructrice pour les deux pays et pour le monde.
Histoire-géographie. Problématique générale : Pourquoi et comment les États-Unis et l'URSS s'affrontent-ils entre 1947 et 1991 ? I. AUX ORIGINES DE LA GUERRE FROIDE. A. Deux modèles...
La guerre froide (1947-1991) est une période d'affrontement idéologique entre les Etats-Unis et leurs alliés contre l'URSS et les pays communistes. Un lieu se distingue de cette Guerre Froide : Berlin et sera considéré comme la source d'affrontement principal en Europe puisqu'elle opposera les deux grandes puissances et leurs ...
Résumé : Plan détaillé, la guerre froide. Recherche parmi 299 000+ dissertations. Par Elfie Dess • 25 Avril 2021 • Résumé • 383 Mots (2 Pages) • 954 Vues. Suite à la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS sont deux superpuissances qui s'affirment au niveau mondial.
Cette période est appelé la guerre froide, elle va durer de 1947 à 1991. Problématique : Comment se manifeste la guerre froide ? Comment l'opposition entre les 2 blocs a lieu ? Quelles sont les raisons de la fin de la guerre froide et leurs conséquences.
Sujet 1 : Composition : La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances. Les deux Guerres mondiales ont débouché sur un désir de mettre en place un Monde en paix. Cependant, les espoirs ont été rapidement déçus.
Le conflit israélo-arabe est nourri par la Guerre froide. La décolonisation se poursuit en Afrique, tandis que l'Amérique latine lutte contre le communisme.
Cette œuvre écrite par le politologue américain et conseiller de l'administration Reagan, Francis Fukuyama, marque la fin du XXᵉ siècle. Elle s'inscrit dans le contexte de la fin de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin.
Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur un exemple d'affrontement entre l'Est et l'Ouest étudié en classe, présentez la bipolarisation du monde durant la guerre froide.
La guerre froide (1947-1991) est une période historique qu'il te faut absolument maîtriser pour les concours. En B/L, elle tombe fréquemment en khôlle ou en dissertation. Pour les A/L, elle est au cœur du programme d'oral si tu passes l'ENS de la rue d'Ulm en 2023.
1. La France sous le leadership des États-Unis. Une puissance fragilisée. Puissance vaincue en 1940 puis occupée, la France n'a pas après la guerre les moyens dʼune politique ambitieuse : la production industrielle de 1946 représente à peine 40 % de celle dʼavant-guerre.
Du 4 au 11 février, Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta, en Crimée, pour décider du sort de l'Allemagne vaincue. Ils décident des modalités d'occupation de l'Allemagne, divisée en quatre zones d'occupation. Berlin, en zone soviétique, sera aussi découpée en quatre secteurs.
En proposant une lecture géographique des textes des Beirut Decentrists, nous espérons renouveler la perspective sur la guerre, sur les femmes dans la guerre, sur la perception de la ville et la façon de faire avec la mémoire de celles-ci
Ces pages contiennent des recueils de citations de la guerre froide faites par des dirigeants politiques, des personnalités et des historiens de la guerre froide (1945-1991). Ces citations ont été recherchées et compilées par les auteurs d'Alpha History.
La cause est entendue : le triomphe des démocraties libérales sur le nazisme a inauguré une seconde modernité conforme aux « valeurs » de l'occident - respect des droits humains, universalité, quête du bien-être, démocratie et justice, caractères fondateurs de l'ouest face à son antagoniste soviétique. Or les continuités de carrières et d'idées interrogent : la guerre froide ...